Pour une procédure initiatique et éducationnelle à la culture citoyenne de la guerre perpétuelle en République Démocratique du Congo : « Je fais la guerre, donc je suis, et on ne met pas la main sur moi »

(Par OSONGO-LUKADI Antoine-Dover, Docteur en Philosophie et Lettres
Professeur d’Universités)
- Dédicace
Je dédie cet article
-Au camarade Marcel NGOYI KYENGI, Directeur-Editeur du journal La Prospérité, mon frère et ami littéraire et de la gauche politique.
-A son Excellence et Excellent Ministre de la Justice Constant MUTAMBA, pour la dignité et la liberté données au peuple congolais grâce à sa lutte contre la corruption, l’injustice et le deux poids deux mesures.
-Aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) pour leur courage malgré le peu de moyens et le comportement irresponsable de la communauté internationale, soi-disant.
Bruxelles (Belgique), le 26 janvier 2025
16 :07
- Le Pape François et le dépit du complexe de Jack London
« Non, non, mille fois non ! Ne me parlez de comprendre les Noirs.
La mission du Blanc est d’être le fermier du monde
et il n’a pas à s’attarder à des contingences
aussi dangereuses qu’inutiles »(Jack LONDON,
L’Inévitable Blanc, Robert Laffont, Paris, 1985, p. 578,
cité par Serge LATOUCHE, L’Occidentalisation du monde,
La Découverte, Paris, 1989, 1992,2005)
Donc, bien plus que l’Afrique, quand on entend cette déclaration de Jack London, la République Démocratique du Congo, pays-continent aux ressources naturelles grandioses et objet de toutes les convoitises, envies, jalousies, haines diverses, malheureusement moins créatrice, productrice et inventrice et ce disant au rabais de développement et de transformation, reste un cas spectaculaire de dépit voire de déni ontologique, anthropologique et culturel, c’est-à-dire politique, sociologique économique, technologique, historique et civilisationnel.
La faute n'étant pas toujours du côté où l’on pense souvent mais sinon de son propre côté en tant que peuple, nation, pays ou Etat. Le philosophe français Jean-Jacques Rousseau avait cette phrase évocatrice parce que révélatrice « Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l’esclavage ».
Mais attention, ces propos ne doivent pas uniquement être entendus que dans le sens où l’on veut uniquement les orienter habituellement contre les gouvernants, mais également les entendre au sens d’appel à la capacité créatrice, productrice, inventrice des peuples, citoyens face, par exemple à la guerre que l’Occident officiel mène contre la République Démocratique du Congo en la faveur de ses multinationales, en utilisant le Rwanda, l’Ouganda comme ses supplétifs pour sa déstabilisation chronique, parce que dans l’idée de l’Occident officiel, la stabilité des institutions républicaines de la RDC serait contre-productive pour la spoliation, le vole, l’accaparement de ses richesses et ressources naturelles.
C’est la raison pour laquelle au lieu d’une paix perpétuelle (préconisée pourtant par Emmanuel Kant, l’un des meilleurs d’entre eux les occidentaux réunis), on a l’impression que l’Occident officiel a opté au contraire pour une « guerre perpétuelle » sur le sol et les terres de la République Démocratique du Congo ; une guerre sans fin aussi longtemps que ce sera possible pour pouvoir garantir ses intérêts économique, minier, politique, culturel, historique, civilisationnel, intellectuel et technologique.
La Présence de l’ONU et de messagers pour la paix n’est qu’une façon d’endormir le peuple redécéen et ses dirigeants afin justement de prolonger in fine la guerre hybride de l’Occident officiel consistant dans sa conquête minière, financière, économique, sociologique, technologique de la malheureuse République Démocratique du Congo.
Justement, lors des Vingt-Huitièmes Journées Scientifiques de l’USAKIN du 18 au 21 Décembre 2024, nous avons premièrement proposé que la « guerre » consistait le seul argument pour pouvoir garantir définitivement la paix tant dans les grands lacs africains, et en République Démocratique du Congo en particulier, que dans le concert de nations du monde entier ; secondement que la déclaration papale pour et sur laquelle se réfugient tant le Sud Global que la RDC plus particulièrement pour penser qu’il s’agissait d’une vindicte du Pape François contre l’Occident Officiel n’en était pas une, mais au contraire un appel global à la responsabilité des peuples de l’univers à ne pas se détruire les uns et les autres et également à éviter de s’auto-détruire, faisant que l’impérialisme n’est plus, à en croire le Saint Père, une exclusivité occidentale, mais également afro-africaine.
La thèse contre laquelle nous formulons nos cinq antithèses, est intitulée « pour une paix durable en république démocratique du Congo et dans la sous-région des grands lacs ». Cette thèse tire sa source de la déclaration « ôtez vos mains de la RDC, ôtez vos mains de l’Afrique » prononcée par le Pape François lors de sa visite historique en RDC le 1 février 2022.
Pour bien comprendre, analyser, interpréter et expliquer cette déclaration-choc voire préoccupante du Saint Père, il nous est venu cette hypothèse : Si formellement et fondamentalement nous partons de la conviction selon laquelle la déclaration papale est satirique, énigmatique, anonymique voire foncièrement ambiguë dans la mesure où elle ne cite personne, c’est qu’une lecture sérieuse, serrée, approfondie au plan culturaliste c’est-à-dire politique, sociologique, psychologique, historique, civilisationnelle, s’y impose pour pouvoir identifier justement celui qui met ou ceux qui mettent la main sur la RDC et sur l’Afrique subsaharienne en général. En effet le caractère énigmatique, anonymique, ambiguë de la déclaration papale ne permet pas dans l’état de déterminer qui est celui ou ceux qui sont visés comme contrevenants au tissu ontologique, anthropologique ; bref culturaliste de l’homme congolais et en grande échelle de l’homme africain subsaharien.
Littérairement compris, le Pape François a utilisé une satire, c’est-à-dire une figure de style pour parler de quelqu’un ou d’un groupe de gens, mais sans les nommer ouvertement.
Ainsi donc bien malin est celui qui dans ces conditions-là doigtera avec certitude les véritables coupables de la détresse des Africains subsahariens et des Congolais rédécéens plus particulièrement. La figure satirique de cette déclaration papale a certainement créé un imbroglio voire une confusion, surtout du côté congolais et africain où très rapidement, sans s’y investir au préalable dans une analyse raisonnée, réfléchie, c’est-à-dire épistémique et praxique, où des coupables furent vite trouvés : l’homme euro-occidental. Le Pape François devenant lui-même le porte-parole voire le bouclier d’un Congo volontairement décadent, acculturé, aliéné car incompétent complet, global et dans une large mesure d’une Afrique subsaharienne aussi vulgaire qu’incompétente et sadique à la merci des puissances de l’OTAN, de l’UE, du FMI, de la BM et leurs branches dissuasives judiciaire et armée le TPI et l’ONU ! Un malentendu qui a évidemment semé un climat de suspicion généralisé au sein de ce qu’on appelle vulgairement, anarchiquement, car sans contenu praxique réel, la « communauté internationale », le tout dans un déluge, sans précédent naguère de condamnations et d’accusations gratuites et aveugles de culpabilité de part et d’autre.
C’est pourquoi pour ne pas tomber dans le même piège, de généralisation hâtive, nous avons recouru aux principes appris respectivement en philosophie et en droit que sont le doute méthodique, la critique pure, l’épochè ou la mise entre parenthèses d’un côté et la présomption d’innocence en science du droit d’un autre côté.
De notoriété, les méthodes cartésienne, kantienne et husserlienne restent un processus exemplaire pour parvenir à la vérité, à la certitude indubitable en philosophie et dans la vie courante tandis qu’en science du droit, le principe bien connu de la présomption d’innocence est celui où avant le prononcé de culpabilité, tout accusé est présumé innocent. Or dans la précipitation émotionnelle propre des Congolais et des Africains d’une manière générale, c’est Senghor, un africain noir pure souche qui le dit haut et fort, du haut de son emblématique courant philosophico-sociologique et politique nommée la négritude-, que « la raison est Hélène et l’émotion nègre », car chez l’homme noir l’apport rationaliste philosophique est abandonné au profit de l’émotion et du sentiment.
Face à cette déclaration papale on a ainsi de bonne ou de mauvaise foi refusée d’être méthodique et précautionneux. Or lire dans la pensée du Pape François aurait été pourtant la chose la plus objective et équitable qui soit pour mettre au grand jour d’éventuels acteurs auxquels il pensait qui « mettent la main sur la RDC et sur l’Afrique subsaharienne ». D’où l’exigence d’une méthodologie à deux têtes à laquelle nous recourûmes consistant de prime abord dans une « herméneutique-historico-psychologico-praxéologico-structurale »et ensuite dans une « herméneuitique-phénoménologico-constative-explicative-descriptive ».
Leur exigence nous a conduit sur une interprétation, une explication des faits historiques, culturels, civilisationnels, politiques susceptible d’affirmer ou d’infirmer les propos du Pape François. Or en lieu et place d’une analyse épistémique et praxique et qui plus est d’une telle méthodologie d’interprétation et de compréhension ouverte et fouillée, Congolais et Africains subsahariens lambda – pire encore même dans les sommités scientifiques universitaires – nous ont fait carrément consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement du Léopold-Sédar Senghor, sorti pour le besoin de la cause du placard, mais malheureusement pour venir justement confirmer la part largement émotionnelle, sentimentale imputée à l’homme afro-noir par l’Allemand G.W.F. Hegel dans sa « Raison dans l’histoire.
Une thèse ouvertement partagée, nous venons de le voir, il y a un moment, par Senghor confortant ainsi donc foncièrement Hegel dans ses convictions ethnocentristes sur l’homme afro-noir, cela malgré les nuances décisives apportées par E. Kant en la matière dans son cours de « Philosophie de l’Histoire ». Dont c’est le piège auquel nous ne voulions pas, à notre tour, nous laisser nous y enfermer.
Le pari consistait plutôt à rester rationnel, autrement dit objectif jusqu’au bout pour ne pas désigner dans la précipitation émotionnelle, irréfléchie des coupables tout désignés, sans au préalable prospecter davantage ni enquêter profondément le sens de cette déclaration papale. Parce que nous restons convaincu que l’homme congolais lui-même est le premier responsable de sa propre déliquescence politique, économique, sociologique, technologique.
Et de même pour l’homme africain subsaharien dans sa globalité. Si après plus de six décennies d’indépendance politique, l’homme euro-occidental blanc « met » la main ou continue à le faire sans désemparer sur la RCD et sur l’Afrique subsaharienne, ce qu’il le fait grâce et avec les complicités internes, c’est à-dire avec la bénédiction des Congolais et des Africains subsahariens eux-mêmes. En effet l’impérialisme extérieur ne se réaliserait jamais, sans la collaboration de l’impérialisme intérieur.
En vérité soixante-quatre ans après la décolonisation, l’influence euro-occidentale en RDC et dans les pays africains-subsahariens, est volontaire, motivée, assumée voire même délibérément choisie, plutôt que dictée, imposée de l’Occident ou d’ailleurs.
D’où dans cette déclaration papale, c’est toutes les races et nationalités confondues qui sont visées et concernées, il y a des Congolais, des Africains subsahariens, des Européens occidentaux, des Américains, des Asiatiques, des Australiens.
Au fait tout le monde, sauf personne, a sa part de responsabilité dans le déclin et la disparition presqu’aujourd’hui irréversible de la RDC dans ses frontières actuelles héritées de la colonisation. Même si notre conviction légitime irréversible est que l’homme congolais en tant qu’incompétent culturel majeur, aliéné et acculturé volontaire, irréfléchi épistémique, vulgaire praxique et donc impérialiste intérieur est le plus grand et premier responsable de la déchéance de son propre pays la RDC.
Reste cependant que pour pouvoir inverser -, car tout n’est jamais évidemment perdu d’avance, tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir, dit-on -, le rapport des forces avec celui qui met ou ceux qui mettent la main sur la RDC et l’Afrique subsaharienne, il va falloir recréer une nouvelle citoyenneté plus créatrice, plus productrice, plus inventrice où la culture et l’éducation à la guerre perpétuelle ne sera pas qu’une nécessité mais également une priorité, si tant il est vrai que de mémoire la guerre est l’essence de l’être humain, une réalité ontologique et anthropologique indiscutable (Th. Hobbes, Grotius, K. Marx).
C’est pour asseoir notre argumentation, que nous avons pu élaborer cinq antithèses suivantes :
1°La guerre est l’essence de l’être humain et précède la paix,
2°La priorisation épistémique et praxique comme un antidote contre l’impérialisme en tant qu’occidentalisme et mondialisme,
3°La nécessaire déconstruction d’une « nouvelle » citoyenneté du développement et de transformation basée sur une éducation plus praxéologique, c’est-à-dire créatrice, productrice, inventrice,
4°La marxisation, la darwinisation et la christianisation mentales de l’homme afro-congolais au détriment d’un christianisme déplacé et contreproductif,
5°La réformation de la RDC de l’Etat unitariste (centraliste) à l’Etat fédéraliste (éclaté) comme antithèse incontournable à la balkanisation, et
6°Au terme du développement de ces cinq thèses, suivra une conclusion provisoire où nous proposerons, mais essentiellement par dépit, plutôt que par forte conviction, au cas où nous échouions dans notre tentative de déconstruire une citoyenneté congolaise plus exemplaire du développement et de transformation, c’est alors que nous proposons d’ores et déjà trois pistes de solution consistant premièrement à amorcer une procédure de recrutement des populations éparses et venant de toute part qu’elles soient blanches, jaunes, rouges, noires pour venir soit remplacer l’homme congolais actuel, incompétent complet, soit cohabiter avec lui pour lui apprendre les vertus de la création, de la production et de l’invention pour le développement et la transformation d’un espace géographique, qu’on appelle un pays, un Etat, une Nation, deuxièmement en la faveur d’un processus médicalisé, en ce compris les manipulations et mélanges génétiques d’ordre anatomico-biologique pouvant donner naissance à un autre type d’homme congolais mieux éduqué, instruit, intelligent, épistémiquement, réflexivement, rationnellement et moralement, éthiquement, mieux, praxéologiquement, troisièmement, enfin, par la voie juridico-administrative par la naturalisation ou l’adoption.
Venons-en à présent à la présentation et au développement de nos cinq antithèses pour et contre la thèse du Pape François et sa réappropriation « inappropriée », qui nous paraît foncièrement contre-productive dans le contexte du développement et de transformation général, total et global de la République Démocratique du Congo et de l’Afrique subsaharienne en général, comme nous l’avions naguère déjà présenté dans une de nos études intitulée « Comment repenser l’« autonomie » du pouvoir politique à l’aune de la mondialisation des marchés et des capitaux ? », in Congo-Afrique, n° 42, 2002, pp. 130-157.
Il nous faut bien comprendre et intégrer que nos antithèses sont pour la paix et donc absolument positives, dans la mesure où quoique faisant l’éloge de la guerre, notre démarche prêche la paix, en même temps qu’elle vénère la guerre comme cette porte-là qui nous conduit à la paix et vice-versa de la paix à la guerre, donc en la faveur de cette dialectique qui tend et sous-tend le survit destinal de l’humanité.
- La guerre est l’essence de l’homme, elle fait et précède la paix
La « première antithèse » porte sur l’énonciation suivant laquelle « la guerre est l’essence de l’homme et qu’en cela elle fait et précède la paix ». Parce qu’à notre humble avis, négocier, c’est savoir manier l’arme pour se faire respecter. C’est Lénine l’un des plus et grands emblématiques chefs d’Etat soviétique qui affirmait comment « on reconnaît la puissance d’un Etat, d’un pays, par sa capacité de nuire ». Qui dira qu’il avait tort, au regard de ce qu’on voit dans les pays qu’on qualifie des super puissances, des pays puissants pour les uns et des pays faibles pour les autres.
Curieusement la notion de super puissance et de puissance est liée à l’épithète développement, transformation économique, politique, technologique, historique, civilisationnel ; bref culturel des pays de l’OCCIDENT-OFFICIEL tandis que le sous-développement, l’absence de transformation, de mouvement sont des concepts relatifs à l’incapacité à la puissance militaire, à l’insuffisance technologique, à l’aliénation culturelle, à l’acculturation volontaire, choisie voire réclamée par les pays et peuples du SUD-GLOBAL.
Disons les choses clairement. Nous constatons, expérience aidant, qu’au fait c’est la guerre qui permet le développement et la transformation politique, économique, technologique, historique, civilisationnelle, culturelle, sociologique de l’hémisphère NORD et l’incapacité voire la « souciance » des pays et peuples Etats et nations du SUD-GLOBAL pour la paix ; une « souciance » dictée par sa référence aux valeurs, vertus et principes hérités du catholicisme christianiste romain, dont les argumentations phares -, pourtant un frein au développement et à la transformation, en tant qu’elles bloquent les citoyens du SUD-GLOBAL qui s’en réfèrent et en font usage -, dont « Laissez la vengeance à Dieu, « Tendez donc les deux joues droite et gauche pour recevoir la gifle du tortionnaire », « Le royaume des cieux est pauvres, c’est-à-dire aux pauvres qui ont laissé les autres s’y enrichir », etc.
Notons donc que DIEU lui-même, créateur de la Terre et du Ciel, est le modèle archétype même de la guerre. Son combat perpétuel avec l’un de ses anges, SATAN, qui s’est transformé en une lutte millénaire entre le Bien et le Mal, est le symbole même de cette essence guerrière de sa créature raisonnée et réfléchie que nous sommes – nous les humains. C’est ce qui justifie notre formule « la guerre est l’essence de l’homme ». Elle est son instinct primordial. Chacun en naissant, en grandissant, en vivant et en mourant fait sa petite ou grande guerre pour se maintenir comme existant (Sartre) ou ek-sistant (Heidegger). Il en est ainsi fait de notre environnement. Ce qui n’est pas nécessairement toujours de mauvais augure. Car en effet il n’y a pas de paix, sans guerre et inversement de guerre, sans paix. La guerre précède et transcende la paix. C’est la guerre qui amène la paix. Qui veut la paix, prépare la guerre, est-il écrit. Tout en effet part de cette recommandation divine « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », et « Aide-toi et le Ciel t’aidera ». Pour bien assoir nos antithèses et particulièrement notre première antithèse, nous allons essayer de comprendre, d’analyser, d’expliquer, en confrontant Thomas Hobbes et Emmanuel Kant, qui parlent respectivement de l’essence de la guerre dans l’être humain et de la paix perpétuelle en tant que vertus salvatrices de l’être humain. Olivier Dekens note comment Grotius (1583-1625), juriste et philosophe hollandais (était) l’un des principaux représentants de la doctrine du droit naturel ; comment dans son Droit de la guerre et de la paix, il définit les fondements de l’Etat juste et les différents modes possibles de relations entre les Etats ; enfin comment il a élaboré surtout une théorie de la guerre dont l’influence a été considérable (DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, p. 29).
Pour bien préciser la pensée, O. Dekens signe cette déclaration de Grotius : « Sur le point de traiter de traiter du droit de la guerre, nous devons voir ce que c’est que la guerre, ce que c’est que le droit dont il s’agit. Cicéron a défini la guerre : « Un débat qui se vide par la force. » Mais l’usage a prévalu de désigner par ce mot non pas une action, mais un état ; ainsi la guerre est l’état d’individus qui vident leurs différends par la force, considérés comme tels. Cette définition générale comprend toutes les sortes de guerres dont il sera parlé par la suite ; car je n’en exclus pas la guerre privée qui, étant plus ancienne que la guerre publique, et ayant incontestablement la même nature, doit pour cette raison être désignée par ce seul et même nom, qui lui est propre » (GROTIUS cité par DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, p. 29).
Nous semblons opposer deux auteurs dont Th. Hobbes comme théoricien de la guerre et l’autre E. Kant comme théoricien de la paix. Pour Thomas Hobbes, l’image de l’homme et de la société est peinte dans cette formule devenue virale selon laquelle « l’homme est un loup pour l’homme », en latin « homo homini lupus » « De Cive » (1642) ; ses principaux ouvrages sont De Cive, Autour des éléments de la loi naturelle et politique (1640) et le Leviathan (1651).
Contractualiste, Hobbes tente de fonder l’ordre politique sur un pacte entre les individus afin que l’homme soit un auteur décisif dans l’édification de son monde social et politique. Son but est de sortir l’homme de l’état primitif et de fonder un état artificiel sur les bases de la raison : passage de l’état de nature à l’état civil. Pour Hobbes l’homme est sociable par crainte de la mort violente, qu’il fait la société avec ses semblables. L’état de nature est un état de la guerre de TOUS contre TOUS (Bellum omnium contra omnes). L’état civil c’est l’incarnation du pouvoir souverain : c’est-à-dire de l’ordre social coercitif : autrement dit un contrat passé entre les individus pour fonder la souveraineté : par ce contrat chacun transfère tous ses droits naturels, à une « PERSONNE » appelée SOUVERAIN, en devenant aussi « ACTEUR » de tous les actes du SOUVERAIN.
Quant à Emmanuel Kant, il est connu en philosophie pour ses trois légendaires « CRITIQUES » : critique de la raison pure (que m’est-il permis de savoir ? », critique de la raison pratique (que dois-je faire ?), et critique du jugement ou de la faculté de juger (que m’est-il permis d’espérer ?).
Or un reproche lui avait été fait de n’avoir pas « critiqué » la politique ; un reproche que nous avions pensé combler dans notre article intitulé « Kant et la Gestion de l’Espace publique. Critique conceptuelle de la « Communauté internationale » et Refondation d’une « Critique de la raison politique », in Revue Africaine du Savoir-Institut Africain du Savoir-Bibliothèque Royale Albert 1er de Belgique, Vol. 9, n9, 2018, en nous fondant sur son ouvrage « Projet de paix perpétuelle » ; ouvrage dans lequel Kant est contre la guerre et fait plutôt l’éloge de la paix ; et où à la suite d’Olivier DEKENS, nous épinglons une première section dans laquelle Kant énumère six articles préliminaires d’une paix perpétuelle entre les Etats.
Mais dont à raison de l’économie du temps, nous nous limiterons à la première des conditions minimales pour qu’une paix, selon Kant, soit possible selon laquelle » « nul traité ne peut mériter ce nom s’il contient une réserve qui donnerait matière à une guerre future » (E. KANT cité par DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, p. 21).
R. SAFRANSKI dans son ouvrage « Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ? » met en évidence également trois tendances suivantes pour une paix perpétuelle entre Etats premièrement l’évolution démocratique consistant à consulter le peuple avant le déclenchement de toute guerre ;deuxièmement la force civilisatrice du commerce mondial, consistant à privilégier le commerce mondial, qui est incompatible avec la guerre, la puissance de m’argent (parce que Kant pense que les Etats sont dans l’obligation de promouvoir la paix au lieu de se battre les uns contre les autres et inversement et troisièmement, enfin, le rôle croissant de la sphère publique, « dont » c’est le principe de publicité selon laquelle porter les questions politiques sur la scène publique contraindra la guerre à se défendre à coups d’arguments, car la publicité somme la guerre de se justifier, d’argumenter ou de s’argumenter.
Or trois remarques, mais en vérité des faiblesses, pour l’instant, sont soulevées par R. Safranski, H. Arendt voire J. Habermas contre la théorie kantienne sur la paix :
En premier lieu,
R. SAFRANSKI reprenant la deuxième tendance pour la paix selon laquelle l’esprit commercial doit être privilégié car il est incompatible avec la guerre, la puissance de l’argent étant la plus sûre, faisant que les Etats se verraient dans l’obligation de promouvoir la paix au lieu donc de se battre les uns contre les autres et inversement, malheureusement, pense que « Kant ne pouvait pas deviner où mènerait l’impérialisme chauffé à l’économie, et quelles énergies, quels motifs nouveaux la concurrence capitaliste fournirait à la guerre » (R. Safranski cité par DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, p. 21).
En deuxième lieu,
Hannah ARENDT « Tout laisse à penser que le problème de Kant, à cette période de la vie tardive de sa vie – lorsque la révolution américaine et plus encore la Révolution française l’eurent pour ainsi dire éveil de son sommeil politique (comme Hume l’avait, dans sa jeunesse, réveillé du sommeil dogmatique et comme Rousseau l’avait tiré, à l’âge mûr, du sommeil moral) – était le suivant : comment concilier le problème de l’organisation étatique avec sa philosophie morale, autrement dit avec le précepte de la raison pratique ? Et, fait surprenant, il n’ignorait pas que sa philosophie morale ne pourrait lui être d’aucun secours. Aussi prit-il ses distances à l’égard de toute position moralisante et comprit-il que le problème était de contraindre l’homme à devenir un bon citoyen, même s’il n’est pas moralement bon » (ARENDT H. cité par DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, pp. 36-37).
En troisième lieu,
J. Habermas juge que « Le concept kantien d’une alliance des peuples qui soit permanent tout en respectant la souveraineté des Etats, n’est pas consistant. Il faut que le droit cosmopolite soit institutionnalisé de telle manière qu’il engage les différents gouvernements. La communauté des peuples doit à tout le moins être capable d’amener ses membres, sous peine de sanctions, à respecter le droit. Ce n’est que de cette manière que le système instable est fondé sur des menaces réciproques des Etats souverains qui s’affirment par eux-mêmes se transforme en une fédération dotée des institutions communes, laquelle, tout à la fois, assume ders fonctions étatiques, régule juridiquement le rapport existant entre ses membres, et contrôle le respect de ces règles.
Le rapport externe des relations internationales entre Etats qui constituent de simples environnements les uns pour les autres, relations qui sont régulées par des contrats, est alors modifié par un rapport interne entre membres de l’organisation, rapport cette fois fondé sur un règlement ou sur une Constitution » (HABERMAS J. cité par DEKENS O., Projet de paix perpétuelle. Texte intégral, Bréal, 2002, pp. 37-38).4.
On voit très bien le caractère tant naïf que foncièrement formaliste des recommandations kantiennes sur ce qu’il appelle « paix perpétuelle » c’est-à-dire « définitive » ; le même formalisme qui a caractérisé et déterminé sa loi morale et/ou éthique sur sa formulation d’un impératif catégorique dans son ouvrage intitulé « Critique de la raison pratique », car inapplicable dans la réalité sinon seulement envisagé, espéré.
La « deuxième antithèse » consiste dans la « priorisation épistémique et praxique de l’espace géopolitico-culturaliste africain subsaharien et congolais en particulier comme un antidote à l’impérialisme en tant qu’occidentalisme et mondialisme » (OSONGO-LUKADI A-D, « Comment repenser l’« autonomie » du pouvoir politique à l’aune de la mondialisation des marchés et des capitaux ? », in Congo-Afrique, n° 42, 2002, pp. 130-157).
En effet dans cette première antithèse, nous annonçons aux auditeurs l’identité des deux maladies, deux carences, deux déficiences ontologiques dont souffre l’homme africain subsaharien congolais : primo la déficience épistémologique, et secundo la déficience praxéologique. Si cet homme est autant malade et déficient ontologiquement, plutôt que victime d’impérialisme comme occidentalisme, mondialisation et mondialisme, c’est à cause de son épistème incohérent, sénile, inutile, futile et de son comportement matérialiste (« chiffré » voire « friqué »). Cette deuxième antithèse comporte quatre sous-antithèses suivantes.
La « première sous-antithèse » énonce que l’impérialisme s’installe en Afrique subsaharienne et en République Démocratique du Congo en la faveur de la ruse et des dérives. Notre principale thèse sur cette question en est que c’est par la ruse de l’homme euro-occidental et les dérives proliférantes dont est volontairement et/ou involontairement, consciemment et/ou inconsciemment l’homme afro-subsaharien que l’impérialisme extérieur exercé, pratiqué par l’homme euro-occidental met la main sur l’homme africain subsaharien en général et sur l’homme congolais en particulier.
Compte tenu du temps qui nous est imparti, on nous permettra simplement d’égrener la liste d’auteurs euro-occidentaux qui comprennent et expliquent honnêtement cette ruse euro-occidentale, s’identifiant sensiblement, principalement en impérialisme extérieur. C’est dans ce contexte que Jean Ziegler dans son livre « Les nouveaux maîtres du monde.
Et ceux qui leur résistent, épingle, entre autres, ce qu’il nomme « l’idéologie du maître », en expliquant comment « « Toute idéologie assume une double fonction : elle doit signifier le monde et permettre à chacun de dire sa place dans le monde. Elle est donc à la fois explication totalisante de la réalité et structure motivationnelle des acteurs singuliers » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002, p. 70).
Or « l’idéologie des dominants, si elle s’impose aux dominés ne ment donc pas seulement à ceux-ci : elle mystifie aussi ceux qui la propagent. Et il n’est pas rare que les principaux protagonistes de la mondialisation croient eux-mêmes à leur mission bienfaisante. Quoi qu’il en soit, la pratique réelle de l’oligarchie sous le règne de laquelle opère la mondialisation est jugée bonne à partir des paramètres fournis par des énoncés faux » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002, p. 71).
Cette idéologie pénible – c’est le mot que nous mettons dans la bouche de J. Ziegler même s’il ne nous démentira point – c’est le libéralisme : « Idéologie noble ! écrit-il, le néo-libéralisme opère en se servant du mot « liberté ». Foin des barrières, des séparations entre les peuples, les pays et les hommes ! Liberté totale pour chacun, égalité des chances et perspectives de bonheur pour tous. Qui n’y adhérerait ? Qui ne serait pas séduit par d’aussi heureuses perspectives ? La justice sociale, la fraternité, la liberté, la complémentarité, l’ordre librement accepté, la loi qui libère, les volontés impures transfigurées par la règle commune ? Des vieilles lunes.
D’archaïques balbutiements qui font sourire les jeunes et efficaces managers des banques multinationales et autres entreprises globalisées ! » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002, pp. 71-72). Pour J. Ziegler tout ceci n’est que des écrans de fumées, puisque rien n’est ni vrai ni cohérent. C’est plutôt « Le gladiateur, dit-il, qui devient le héros du jour » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002, p. 72).
Et pourtant chez J. Ziegler, l’« idéologie des maîtres », c’est celle où « Les maitres règnent sur l’univers autant par leurs énoncés idéologiques que par la contrainte économique ou la domination militaire qu’ils exercent. La figure idéologique qui guide leur pratique porte un nom anodin : « Consensus de Washington. »
Il s’agit d’un ensemble d’accords informels, de gentleman agreements, conclus tout au long des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix entre les principales sociétés transcontinentales, banques de Wall Street, Federal Reserve Bank américaine et organismes financiers internationaux (Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc.) » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002,). Ce qui lui fait dire, citant Guy Debord, que « Pour la première fois les mêmes sont les maitres de tout ce que l’on fait et de tout ce que l’on en dit. » (ZIEGLER J., Les nouveaux maîtres du monde. Et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002, p. 63).
Quant à Serge Latouche, dans son ouvrage « L’occidentalisation du monde », Serge Latouche élabore une théorie sur l’Occident, et l’occidentalisme qui en découle, d’une façon très remarquable, car très pertinente. Dans son ouvrage perspicace intitulé « L’occidentalisation du monde », l’auteur pointe du doigt ce qu’il appelle « La singularité occidentale ».
Il la décrit de la manière selon laquelle « La mondialisation actuelle nous montre ce que le développement a été et que nous n’avons jamais voulu voir. Elle est, en effet, le stade suprême de l’impérialisme de l’économie. Rappelons la formule cynique d’Henry Kissinger : « La mondialisation n’est que le nouveau nom de la politique hégémonique américaine. » lancé par Henry Truman en 1949 pour permettre aux Etats-Unis de s’emparer des marchés des ex-empires coloniaux européens et éviter aux nouveaux Etats indépendants de tomber dans l’orbite soviétique. Et avant l’entreprise développementiste ?
Le plus vieux nom de l’occidentalisation du monde était tout simplement la colonisation et le vieil impérialisme. Si le développement, en effet, n’a été que la poursuite de la colonisation par d’autres moyens, la nouvelle mondialisation, à son tour, n’est que la poursuite du développement avec d’autres moyens. Mondialisation et américanisation sont des phénomènes intimement liés à un processus plus ancien et plus complexe : l’occidentalisation » (LATOUCHE S., L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris, 1989, 1992, 2005, pp. 9-10).
De même « Aujourd’hui, l’Occident est une notion beaucoup plus idéologique que géographique. Dans la géopolitique contemporaine, le monde occidental désigne un triangle enfermant l’hémisphère nord de la planète avec l‘Europe de l’Ouest, le Japon et les Etats-Unis. La triade Europe, Japon et Amérique du Nord, rassemblée parfois sous le nom de Trilatérale, symbolise bien cet espace défensif et offensif. Le G8, ce sommet périodique des représentants des huit pays les plus riches et les plus développés (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, Canada, Russie), tient lieu d’exécutif provisoire de cet ensemble » (LATOUCHE S., L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris, 1989, 1992, 2005, p.11).
Pour Ed MORIN, dans « Culture et barbarie européennes », il a cherché de loin les racines occidentales de la barbarie en expliquant comment « Si l’Europe occidentale a été le foyer de la domination barbare sur le monde, elle a également été le foyer des idées émancipatrices, comme celles des droits de l’homme et de citoyenneté, grâce au développement de l’humanisme. Les idées émancipatrices ont été reprises par les représentants des peuples colonisés et asservis : c’est à partir des droits des peuples, droits de l’homme et droits des nations, que le processus d’émancipation a pu avoir lieu » (LATOUCHE S., L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris, 1989, 1992, 2005, p.64).
En soulignant dans le même ordre d’idées comment « la mondialisation, phénomène dont la date de naissance symbolique est 1492, s’est principalement manifestée par la traite des Noirs et de nombreux autres asservissements. Mais j’ajoutais qu’une deuxième mondialisation se met en marche, presque dans le même temps : celle des droits de l’humanité, du droit des nations, de la démocratie.
Enfin, nous sommes aujourd’hui dans une mondialisation contradictoire : les progrès fantastiques de la mondialisation techno-économique suscitent, mais aussi étouffent, une mondialisation citoyenne et humaniste » (LATOUCHE S., L’occidentalisation du monde, La Découverte, Paris, 1989, 1992, 2005,pp.64-65).
Pour conclure provisoirement, nous notons comment Rüdigger SAFRANSKI dans son ouvrage intitulé « Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ? », il explique le phénomène de mondialisation Pour comprendre voire spécifier concrètement le phénomène de mondialisation, en montrant « Tout d’abord quelques faits. Nous vivons une ère de mondialisation, aucun doute là-dessus. Depuis la bombe atomique, une communauté mondiale vit sous la même menace. Les fusées peuvent atteindre n’importe quel point de la Terre. Le potentiel d’armes nucléaires rend possible le suicide collectif de l’humanité et une dévastation planétaire. On peut disposer de la vie sur le globe. Les guerres ne sont plus seulement régionales ni menées par les seuls Etats ».
Un pouvoir découplé des Etats ou un terrorisme aux bases étatiques mouvantes étroitement à la criminalité organisée opèrent à l’échelle mondial et tentent de s’approprier des armes de destruction. Nous savons cela depuis le 11 Septembre, mais c’était à craindre dès avant. Un détournement terroriste de la force atomique civile, une frappe sur une centrale atomique par exemple, peut avoir lieu à tout moment.
D’autres techniques des plus dangereuses dont l’emploi reste, pour l’instant, encore réservé au domaine civil, telles que la biotechnologie et le génie génétique, peuvent être utilisées à des fins terroristes – et leur impact serait alors planétaire. Ces quelques pistes suffiront à indiquer que la mondialisation moderne a commencé avec une mondialisation de la peur et de l’effroi » (SAFRANSKI R., Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, pp. 17-19).Cependant, ce qui vient d’écrit, la mondialisation techno-scientifique, n’est pas pour R. Safranski le seul danger de la mondialisation, puisqu’il y en a une autre forme plus sournoise et dévastatrice touchant et détruisant l’humain et la nature en plein cœur, dont c’est la mondialisation économique.
En effet, « Selon une définition de l’OCDE, la mondialisation de l’économie est le processus qui lie les marchés et la production des différents pays dans un rapport d’interdépendance de plus en plus étroit, du fait du commerce transfrontalier des biens, des services et de la main-d’œuvre, ainsi que du mouvement des capitaux et des technologies » (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, p.18).
Dans le même ordre d’idées, « La mondialisation, c’est le triomphe du capitalisme devenu seul et unique modèle économique dominant après l’effondrement du bloc de l’Est. En dépit des différences politiques et religieuses persistantes, les structures politiques économiques et techniques s’uniformisent – à des niveaux de développement, il est vrai, fort divers.
Il existe des mouvements contraires, mais ils restent tributaires du capital et de la technique occidentale » (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, pp. 18-19).R. SAFRANSKI différencie la mondialisation et le mondialisme, en expliquant comment « Le mondialisme comme idéologie produit l’image d’une société mondiale plus uniforme qu’elle n’est en réalité.
Il omet souvent le fait qu’à mesure que l’homogénéité s’accroît dans certaines régions, d’autres se coupent de façon dramatique de la marche du monde. Pendant que certaines sociétés et régions communiquent entre elles, d’autres deviennent comme des « taches blanches » sur la carte et reculent à des stades antérieurs de développement. Dans un monde qui communique en temps réel, les inégalités se creuse.
De nouvelles zones de temporalité se forment, des fuseaux historiques et non plus horaires. En Afrique, par exemple, les Etats se délitent dans le tribalisme et la guérilla. Féodalité, chevaliers, brigands, piraterie resurgissent ; une pauvreté inconcevable et des luttes sans merci pour survivre annihilent les règles sociales. Le minimum de civilisation disparaît » (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, pp.21-22). R. Safranski ne nie jamais qu’il y ait un apport positif de la mondialisation dans le développement et la transformation des rapports sociaux, mais il récuse le mondialisme qui en découle en tant qu’idéologie où tout en bout de course tous les profits vont, comme K Marx l’avait dit en maintes reprises, dans les mains des plus offrants, c’est-à-dire des capitalistes.
Pour ce faire, il distingue trois variantes de ce qu’il nomme premièrement « mondialisme normatif » que sont le néolibéralisme, l’antinationalisme ou mondialisme idéologique et enfin le mondialisme partagé entre la compassion et l’alarmisme. S’agissant du mondialisme néolibéralistes, pour R. Safranski, c’est la plus puissante voire la plus influente des trois variantes, dans la mesure où « Le mondialisme néolibéral est une entreprise de légitimation idéologique du libre mouvement du capital en quête des conditions favorables pour fructifier (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, p.23)».
On l’a très bien compris, ce n’est pas de l’être humain dont il s’agit, de ses problèmes, ses souffrances, ses dangers, ses risques, ses pauvretés, ses misères non mais des conditions d’investissements pour un capital juteux. Deuxièmement le mondialisme idéologique ou antinationalisme professe un avenir planétaire au détriment des allants et accents nationalistes dans certains peuples du monde. Malheureusement pour R. Safranski, il s’agit d’un vœu vorace, sénile, puéril, futile, car « Si l’on songe aux monstres qui furent engendrés par le nationalisme, c’est hautement souhaitable.
Mais pas plus qu’un autre, le mondialisme antinationalisme ne changera quoique c soit au fondement anthropologique selon lequel la mobilité et ouverture au monde doivent être contrebalancées par l’ancrage dans un lieu » (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, p.26). Quant troisièmement au mondialisme de la compassion et de l‘alarmisme, pour R. Safranski il est celui où « nous contemplons, telle une planète vue de l’espace, la pauvre Terre que nous sommes en train de détruire et qu’il s’agit à tout prix de sauver » (Quelle dose de mondialisation l’homme peut-il supporter ?, p.27).
La « deuxième sous-antithèse » énonce, quant à elle, que l’appel du côté africain subsaharien et congolais en particulier d’une urgence à la maîtrise épistémique et praxique est la seule arme à opposer à l’homme euro-occidentale pour faire échec à l’impérialisme extérieur qu’il lui impose grandiloquement avec envahissement et rempli de mauvaise volonté.
Sur cette urgence à la maîtrise épistémique, nous recommandons l’imprégnation de la « Critique de la raison pure » de Kant, car l’ouverture des peuples à la science est la solution idoine. Que c’est par la science et avec la science qu’il est possible de prime abord à un homme isolé et ensuite à une communauté de se développer, de se transformer, de se créer et de se recréer, de produire et de se reproduire, d’inventer et de se réinventer.
Or qui dit science dit épistémologie. D’où avons-nous interpelé les peuples et races en échec scientifique, technologique à se forger une mentalité scientifique et épistémologique pour prétendre à une vie meilleure et acceptable.
De même qu’il est vrai qu’on peut s’interroger sur la pauvreté, la misère de certains peuples, de certaines races par rapport à la richesse et l’opulence d’autres peuples, mais l’on s’égarerait de penser que le nœud de la solution est politique, sociologique, psychologique, historique, anthropologique ou prioritairement ontologique, il est au contraire épistémologique, car tout ceci ne devient possible à tout être humain qu’en se forgeant une mentalité scientifique (OSONGO-LUKADI A-D, Séminaire de Philosophie de science, Master 1&2, Faculté de Philosophie, Université Catholique du Congo, 2021-2022, (inédit)). Il s’agit d’établir un rapport entre la science et le développement ou encore la transformation d’un peuple, d’un pays, d’un Etat, d’une nation. Et autour de cette relation, construire une maison finalement à trois où l’épistémologie, c’est-à-dire la capacité qu’a tout être humain de se développer et de se transformer par l’importance qu’il accorde à la recherche scientifique et technologique, car l’une ne va jamais sans l’autre, prend le commandement.
Pour sa part, Alvin Toffler est un auteur que nous admirons et citons souvent dans nos textes. Parce qu’il est très pertinent. Parlant de pouvoir, découvrons ce qu’il écrit : « Dans toutes ses applications pratiques, la force est une quantité finie : il existe une limite au-delà de laquelle son emploi détruira ce que nous voulons conquérir ou défendre. Il en va de même pour la richesse : l’argent ne peut tout acheter, et il arrivera un moment où la caisse la mieux garnie se trouvera vide » (TOFFLER A., Les Nouveaux pouvoirs, Fayard, 1991, p. 38).
Le même Alvin Toffler, qui vient de montrer les limites tant du pouvoir politique que du pouvoir de l’argent, nous conseille de faire confiance au contraire au savoir. Ce n’est pas possible qu’autour du chef de l’Etat, au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et partout ailleurs, on ne respecte que le pouvoir et l’argent en défaveur du savoir.
A telle enseigne que pour les faire perdurer, des charlatans sont capables d’inventer n’importe quelle stratégie pour demeurer éternellement au pouvoir, pour rester assis aussi éternellement sur des malles d’argent. Pourtant, nous venons de voir il y a un moment avec A. Toffler, que tout ceci n’est qu’éphémère.
Que le pouvoir, l’argent et la force liée à eux deux ne développent et ne transforment un peuple, un pays et ni encore moins ne forgent une nation. A. Toffler note ce qui suit sur le savoir, qu’il nomme une richesse infinie, « Le Savoir, lui, ne s’épuise pas : il nous est toujours possible d’en créer davantage » (TOFFLER A., Les Nouveaux pouvoirs, Fayard, 1991, p. 38).
« Une autre différence intrinsèque, explique-il, sépare le savoir de la force physique ou de l’argent : en règle générale, si j’utilise un pistolet, vous ne pouvez en même temps utiliser le même ; et vous utilisez un dollar, je ne peux en même temps utiliser le même. Au contraire, nous pouvons tous deux utiliser le même savoir pour nous aider ou nous combattre - et, ce faisant, nous avons de plus une chance de produire un supplément de savoir. Ce seul fait suffit à montrer que les règle du jeu du pouvoir mené sur la base du savoir sont profondément différentes des principes auxquels se fient ceux qui prétendent arriver à leur but par la force et l’argent » (TOFFLER A., Les Nouveaux pouvoirs, Fayard, 1991, p. 38).
Pour sa part, A. Kabou est tout à fait d’accord avec notre préoccupation, quand il montre lui également que l’émergence d’un esprit analytique fécond parait se heurter essentiellement à trois obstacles bien connus, notamment les tabous traditionnels, l’absence de démocratie, et à une pierre d’achoppement insoupçonnée mais de taille :la sorcellerie (KABOU A., Et si l’Afrique refusait le développement ? Paris, l’Harmattan, 1991, p. 92).
C’est ainsi et hélas en lieu et place d’un territoire épistémologique, l’Afrique selon Axelle Kabou est restée une Afrique foncièrement traditionnaliste. L’Afrique est restée profondément ce qu’elle a toujours été : un terroir de traditionalisme. Axelle Kabou ne croit pas à l’aliénation culturelle. Ces mythes ont pour seule fonction d’instaurer un climat de résistance à la pénétration d’idées nouvelles dans les mentalités. L’Afrique n’est pas en danger d’occidentalisation.
Cette pseudo-aliénation a pour fonction de cacher l’extraordinaire homogénéité des modes de pensée en Afrique contemporaine, et l’inexistence d’une couche sociale capable d’assumer les transformations imposées par la détérioration croissante de la situation économique. En effet, l’Afrique ne connaît pas de révolutions sociales. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a aucune différence de mentalité entre les intellectuels et les masses (KABOU A., Et si l’Afrique refusait le développement ? Paris, l’Harmattan, 1991, p. 92).
De telle sorte qu’aucune dictature, selon A. Kabou, ne peut se maintenir durablement dans un pays par son seul pouvoir de répression et de corruption. Seule la préexistence d’un terrain social et culturel favorable explique que de tels régimes puissent prendre racine et prospérer. La vie quotidienne des Africains n’est pas régie par un mouvement de balancier ou les cœurs saignants seraient constamment déchirés entre les deux termes d’une cruelle alternative : être ou ne pas être soi-même.
II n’y a pas, à proprement parler de déracinement, mais plutôt une sorte de mauvaise conscience à l’égard des valeurs traditionnelles. C’est en ce sens que le dualisme tradition-modernité est fallacieux : il postule le progrès des mentalités vers une ouverture après avoir diabolisé les valeurs de la modernité. Le métissage culturel donne un mythe reposant sur la conviction erronée que la compréhension des civilisations et des traditions réciproques est le préalable sine qua non de la communication interculturelle (KABOU A., Et si l’Afrique refusait le développement ? Paris, l’Harmattan, 1991, p. 92).
La « troisième sous-antithèse » consiste dans l’urgence à la maîtrise praxique recommandant à la « Critique de la raison pratique » de Kant, dans laquelle le comportement éthique et/ou moral est astreint au choix libre total est entre l’impératif hypothétique et l’impératif catégorique. Même si le formalisme de la moralité kantienne ne permet pas de changer toujours le penchant de l’être humain quel qu’il soit pour l’impératif hypothétique, il est constamment utile d’en parler autour de soi voire de l’imposer. S’agissant maintenant de l’urgence pour la maitrise praxéologique c’est-à-dire éthique et/ou morale, il s’agira pour l’homme afro-congolais et africain tout court de se mettre à l’école de Kant. En effet le véritable enseignement à tirer, c’est la connexion établie par Kant entre l’acte rationnel et l’acte moral dans tout être humain.
Sans verser dans les particularismes absolument voire inutilement contreproductifs, nous dirons comment en observant l’agir politique de l’homme afro-subsaharien, cette connexion laisse souvent à désirer. Nous avons certainement un faible pour Kant – même si sa principale est qu’il a théoriser, disent ses détracteurs, une mémoire formaliste voire donc inapplicable – mais nous ne voyons pas même dans l’intention simplement, un philosophe qui en a élaboré une de plus consensuelle universellement.
C’est pour cette raison que nous devons rendre obligatoire la philosophie pratique (morale, éthique) de Kant en Afrique noire et en République Démocratique du Congo plus particulièrement, où l’humanité, l’humanisation, la socialisation, la socialité sont grandement encore en recule.
Pour rappel, notons que dans la « Critique de la raison pratique », Kant distingue deux impératifs moraux et/ou éthiques dont l’un impératif hypothétique (qui n’est pas moral), et l’autre catégorique (qui est moral).
Pour Kant l’impératif hypothétique n’est pas moral parce qu’il soumet le bien au désir (fais ton devoir si tu y trouves ton intérêt), ou bien si tes sentiments spontanés t’y poussent). Mais l’impératif catégorique est moral parce qu’il n’y a ni conditionnalité ni calcul (fais ton devoir sans conditions).
L’impératif catégorique est quant à lui subordonné à trois formes d’impératifs. Kant part du constat selon lequel parce que les lois que la raison s’impose ne peuvent en aucun cas recevoir un contenu de l’expérience, puisqu’elles doivent exprimer l’autonomie de la raison pure pratique, alors les règles morales ne peuvent consister que dans la forme même de la loi.
D’où la première formulation de la loi : « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle » (première formule du devoir). La deuxième formulation tient au respect de la raison qui s’étend au sujet raisonnable : « Agis toujours de telle sorte que tu traites l’humanité, en toi et chez les autres, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen » (deuxième formule du devoir).
Dans l’esprit de Kant parce que cette deuxième formule nous oblige à considérer tout être raisonnable comme une fin en soi, on doit proscrire tout autant le suicide que l’esclavage.
La troisième formulation part du principe selon lequel les hommes, pour s’unir dans une juste réciprocité de droits et d’obligations, n’ont à obéir qu’aux exigences de leur raison : « Agis comme si tu étais législateur en même temps que sujet dans la république des volontés » (troisième formule du devoir[1]. Puisque chez Kant le respect est le seul sentiment qui a par lui-même une valeur morale, dans cette éthique rationaliste, non parce qu’il serait antérieur à la loi, mais parce que c’est la loi morale elle-même qui produit en moi ce sentiment, par lequel mon orgueil est humilié. La morale de Kant tout en magnifiant la raison humaine, exprime sa méfiance à l’égard de la nature humaine et de tout ce qui est empirique, passif, passionnel, pathologique (HUISMAN D. et VERGEZ A., Histoire des philosophies illustrée par les textes, Nathan, 1996, p. 191, pp. 191-192).
La « quatrième et dernière sous-antithèse » recommande, enfin, à se référer au mouvement panafricaniste tant politique que philosophique constitutif de la négritude d’Aimé Césaire, Léon Damas, Léopold Sédar Senghor, à l’afrocentrisme de Cheikh ANTA DIOP, à l’historicisme panafricaniste de J. Kizerbo, de Théophile Obenga, jusqu’aux idées panafricanistes de Barthelemy Boganda,de Patrice-Emery Lumumba Kwame Nkrumah, Modibo Keita, Mouammar Kadhafi, Thomas Sankara, Nelson Mandela au « recours à l’authenticité de Mobutu Sese Seko, aujourd’hui d’Ibrahim Konate, entre autres, sans oublier le remplacisme-culturaliste de développement et de transformation que nous proposons comme l’un des moyens cruciaux en vue de la rentabilité de la culture afro-subsaharienne et rdécéenne plus particulièrement par la réappropriation des vertus de la créativité, de la productivité, de l’inventivité.
Nous en venons à présent à la « troisième antithèse », impliquant la nécessité pour une déconstruction de la nouvelle citoyenneté afro-congolaise plus créatrice, plus productrice, plus inventrice du développement et de transformation comme nous l’avons déconstruit dans notre conférence intitulée « Pouvoirs, vouloirs et devoirs pour une praxis afro-créationniste dans un monde des partenaires concurrentiels, in Actes des Vingt-Septièmes Journées Scientifiques, organisées du 13 au 16 Décembre 2023 avec le concours financier de Missio Aachen e.V, et publiée dans ma foulée par la revue Pensée Agissante, USAKIN, 2024). Entre autres, dans cette conférence, nous indiquions en quoi et comment l’éducation et l’instruction de la jeunesse sont la clé du développement et de la transformation de l’Afrique subsaharienne et de la République Démocratique du Congo plus particulièrement. Nous conseillâmes, par conséquent, la mise « entre parenthèses » des principes éducatifs, excepté ceux de Noam Chomsky y insistant sur la sensibilité chez l’enfant, hérités de Kant, de Rousseau, de Piaget et de tant d’autres, en tant qu’ils ne reflètent plus ni l’éducation ni l’instruction telles qu’elles devaient être, car submergées et dépassées par les aléas et affres de la modernité apportée et générée par l’Occident officiel, au détriment du Sud global, qui tient encore et toujours aux valeurs traditionnelles. Afrique.
Or en cette matière, il conviendrait bien de regarder tout prêt de nous ou Willy OKEY doyen de la faculté de philosophie a publié en collaboration avec Nkay, un ouvrage intitulé « Valeurs, principes et symboles de la république (composante éducation à la citoyenneté, Unité d’enseignement destinée aux étudiants en L1/LMD, Université Saint Augustin de Kinshasa, Editions de l’Académie de la Paix », et évidemment votre serviteur dans un ouvrage intitulé « Enseigner l’éthique et la déontologie professionnelle et de l’enseignant à l’Enseignement Supérieur de la République Démocratique du Congo et à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe. Questions et réponses philosophico-phénoménologiques et sociologico-pédagogiques sur les prérequis des Enseignants et des Etudiants en matière des « manières d’être » et manières d’agir », Louvain-La-Neuve, CRPIC éditions, Bibliothèque Royale Albert 1er de Belgique Maison de Dépôt, 2024 » afin de renouveler la citoyenneté citoyenne en la faveur des arguments non pas fictifs mais concrets et adaptés aux conditions culturelles de notre environnement en Afrique et dans chaque pays africain avec ses spécificités.
Quant à nous, l’éducation et l’instruction de la jeunesse africaine demeure la seule alternative crédible eu égard aux questions de développement et de transformation de l’Afrique noire et de la République Démocratique du Congo en particulier. Par éducation on entend en gros l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement.
L'éducation inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique, l'éducation a pour but de faire progresser, améliorer et penser par soi-même d'un sujet et la création de cultures. Éducation, instruction ou enseignement. Le mot « éducation » est directement issu du latin educatio de même sens, lui-même dérivé de ex-ducere (ducere signifie conduire, guider, commander et ex, « hors de ») : faire produire (la terre), faire se développer (un être vivant).
Il convient cependant de noter la différence pointée par Mialaret entre les deux étymologies educare (nourrir) et educere (élever) pour saisir la double instance liée au concept d'éducation et dont la conciliation est une problématique pédagogique majeure : nourrir/remplir de connaissances et élever c'est-à-dire maximiser les potentialités des individus selon Mialaret. Pour Émile Durkheim, l'éducation est une « Socialisation méthodique pour la jeune génération ». Enseigner, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances et de valeurs de la vie sociale([1]OSONGO-LUKADI A-D, Enseigner l’éthique et la déontologie professionnelle et de l’enseignant à l’Enseignement Supérieur de la République Démocratique du Congo et à l’Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe. Questions et réponses philosophico-phénoménologiques et sociologico-pédagogiques sur les prérequis des Enseignants et des Etudiants en matière des « manières d’être » et manières d’agir », Louvain-La-Neuve, CRPIC éditions, Bibliothèque Royale Albert 1er de Belgique Maison de Dépôt, 2024).
Or parmi les plus grandes références de la philosophie de l’éducation, avons-nous rappelé, figurent E. Kant, Jean-Jacques Rousseau, J. Piaget même si nous n’entendons plus nous en référer au regard de ce qu’est culturellement devenu aujourd’hui l’homme euro-occidental. Avec la sacralisation des antivaleurs, en tout cas contraire aux recommandations bibliques et du christianisme millénaire qu’il était venu via l’esclavage et le colonialisme imposer à l’homme noir, l’Afrique noire n’entend plus en faire des modèles.
Il y a donc comme une obligation sinon une urgence de trouver en RDC et dans toute l’Afrique d’autres pistes pour forger une nouvelle éducation et instruction à la citoyenneté, qui permette l’affranchissement de l’homme congolais et africain de l’acculturation, de l’aliénation euro-occidentale. Dans un ouvrage tout récent Willy Okey et Flavien Nkay Malu ont le mérite de souligner et de montrer comment « En parlant de développement et de sous-développement, on se réfère aux conditions de vie de la population d’un pays donné. Chaque pays a le devoir d’améliorer tous les aspects de la vie de ses citoyens.
L’ironie de la chose c’est que ce sont ces mêmes citoyens d’un Etat qui doivent travailler pour que cette amélioration de leurs conditions de vie ne soit pas un simple souhait mais se concrétise dans la réalité de leur vie quotidienne. Ceci exige de leur pat des qualités intellectuelles et morales capables de transformer leur vécu quotidien. La qualité des citoyens est donc un facteur majeur dans l’accomplissement du devoir de l’Etat d’offrir à ses citoyens des conditions optimales de vie » (OKEY W. et NKAY FL., Valeurs, principes et symboles de la république (composante éducation à la citoyenneté, Unité d’enseignement destinée aux étudiants en L1/LMD, Université Saint Augustin de Kinshasa, Editions de l’Académie de la Paix, Juin 2024, p. 5).
De même que pour W. Okey et FL. Nkay Malu, « L’éducation est, sans conteste, un atout majeur dans la formation civique des citoyens pour leur permettre d’adopter un comportement digne et responsable dans la gestion de la chose publique. L’éducation dont l’homme a besoin est celle qui lui permet non seulement d’être un homme, mais aussi et surtout d’être citoyen, l’université ou l’enseignement supérieur, comme haut lieu de formation des futurs cadres du pays, est en extirpant en est les antivaleurs qui peuvent mettre en péril la vie de la société.
D’où l’importance de l’éducation à la citoyenneté. Ce cours a pour objectif institutionnel « éduquer l’étudiant, le former pour qu’il devienne un citoyen capable d’aimer passionnément son pays, de chercher à la servir et d’y trouver son propre bonheur » (OKEY W. et NKAY FL., Valeurs, principes et symboles de la république (composante éducation à la citoyenneté, Unité d’enseignement destinée aux étudiants en L1/LMD, Université Saint Augustin de Kinshasa, Editions de l’Académie de la Paix, Juin 2024, p. 5).
Quant à nous, nous estimons que l’exigence d’une éducation à une nouvelle citoyenneté en Afrique passe par les facteurs ci-après :
1°La reconstruction et la prééminence des Académies militaires, 2°L’établissement d’un lien profond entre la culture et l’éducation, parce que cultiver c’est éduquer où il s’agit d’éduquer des enfants conquérants, audacieux, créateurs, producteurs, inventeurs, transformateurs, plutôt que des simples perroquets, récitateurs, poètes, romantiques, pensifs, passifs, théorétiques,
3°La rationalisation du conflit intergénérationnel.
4°La lutte contre l’illettrisme globalisé professionnel d’un côté et l’éradication de l’analphabétisme intimiste global conscient ou inconscient entre d’un côté ceux qui prétendent tout connaître mais ne connaissent rien et d’un côté les voyeuristes numériques « instruits » et « non instruits », qui ont abandonné l’écriture et la lecture, plutôt principale source d’éducation, d’instruction et d’information au profit des images télévisuelles et vidéothèques d’un autre côté,
5°L’intégration de la capacité citoyenne créatrice, productrice, inventrice comme socle du développement et de transformation,
6° L’initialisation et le renforcement épistémologiques et praxéologiques citoyens en tant que facteur du développement et de transformation ontologico-anthropologique,
7°Le refus à l’authenticité comme chantage identitaire, consistant à utiliser les voies de développement et de transformation des pays, des Etats et des nations au seul prétexte de la différenciation et distinction culturelles, se résumant à un abrégé obsolète « nous sommes noirs et avec notre culture et donc notre façon de voir et de progresser selon notre espace et notre temps », 8°Le combat contre l’aliénation mentale et l’acculturation.
9.L’appropriation panafricaine de la science et de la praxis.
10. La marxisation et la darwinisation culturaliste citoyenne africaine subsaharienne.
Au total, et à la lumière de ce qui précède, l’éligibilité à une citoyenneté créatrice, productrice, inventrice panafricaine s’évaluerait proportionnellement
11. à la lutte contre la dispersion juvénile entre nature et culture, en sachant que l’homme « cultivé » n’est pas nécessairement celui qui a étudié ou qui a un diplôme, un doctorat, un brevet ou un certificat, mais sans doute un homme éduqué et donc doté des valeurs éthiques et morales, et enfin
12. A favoriser une jeunesse leadershipique, en se disant qu’il y a une différence flagrante entre leadership et management en ce que le leadership se définit comme étant un charisme naturel permettant d’influencer et de fédérer autour de soi afin d’atteindre un objectif commun.
C’est lorsque ces douze (12) facteurs citoyens panafricains font défaut, que la citoyenneté africaine est infectée par quatre types de citoyens afro-subsahariens intellectuellement défaillants voire controversés déjà énumérés et signalés lors des Vingt-Troisièmes Journées Scientifiques de Décembre 2023(OSONGO-LUKADI A-D., Pouvoirs, vouloirs et devoirs pour une praxis afro-créationniste dans un monde des partenaires concurrentiels, in Actes des Vingt-Septièmes Journées Scientifiques (organisées du 13 au 16 Décembre 2023 avec le concours financier de Missio Aachen e.V), Revue Pensée Agissante, USAKIN, 2024), c’est-à-dire :
1°Les intellectuels-intellectuels, ceux qui ont étudié, obtenu un diplôme et censés ainsi se démarquer de la médiocrité tant épistémique que praxéologique,
2°Les intellectuels-analphabètes, ceux qui effectivement ont étudié et obtenu un diplôme mais dont le niveau épistémique et praxéologique ne reflète aucunement leur niveau et encore moins les différencient des illettrés, des abrutis, des parvenus,
3°Les analphabètes-intellectuels, sont ceux qui n’ont ni étudié ni obtenu aucun diplôme ; qui se sont formés soit sur le tas par eux-mêmes soit structurellement par « autodidactat » mais affichant un niveau de responsabilité épistémique et praxéologique digne voire supérieur aux intellectuels sur la paperasse, et enfin,
4°Les analphabètes-analphabètes, sont ceux desquels on ne peut formellement et fondamentalement rien espérer d’épistémologiquement et de praxéologiquement constructif dans la mesure où leur niveau n’est pas différent de la nature et au contraire éloigné de la culture, cette fois-ci comme esprit cultivé.
Ces quatre types de citoyens sont un danger pour la société. Des vrais cobayes pour l’abrutissement de la citoyenneté au travers lesquels s’incrustent les pouvoirs politiques pour y installer leur dictature d’opinion. En effet c’est simple comme l’exprime Anders Günter, « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s’y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celle d’Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l’éducation, pour le ramener à une forme d’insertion professionnelle.
Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles, médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste … que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des divertissements abrutissants, flattant toujours l’émotionnel, l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique.
Il est bon avec un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de s’interroger, penser, réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme anesthésiant social, il n’y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la publicité, de la consommation deviennent le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté » (Anders GÜNTHER cité par Willy Okey et Flavien Nkay Malu, Valeurs, principes et symboles de la république (composante éducation à la citoyenneté, Unité d’enseignement destinée aux étudiants en L1/LMD, Université Saint Augustin de Kinshasa, Editions de l’Académie de la Paix, Juin 2024, p. 5).
D’où au-delà de tout, l’apport de Noam Chomsky n’en est pas moins très significatif, bien au contraire il mérite donc toute notre attention mais de la manière la plus courte et brève qu’il soit. Les analyses portées par N. Chomsky sur l’éducation sont non seulement pertinentes mais louables dans le contexte africain dominé, aliéné, démuni et terriblement encore privé d’humanisme.
Dans son livre « Pour une éducation humaniste »( CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010)[2], l’auteur prêche en faveur d’une conception humaniste de l’éducation des enfants(CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010,pp. 13-48).
Dans l’ensemble paraphrasant Bertrand Russell, N. Chomsky rapporte que « l’éducation devait avoir pour objectif premier de stimuler et de fortifier les impulsions créatrices pour chacun » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010,p.13). Telle est la conception révolutionnaire de l’éducation des enfants, mettant l’accent sur les impulsions créatrices, c’est-à-dire productrices, inventrices et donc véritablement développementales et transformatrices, comme nous ne cessons de le proclamer constamment dans tous nos travaux voire discours.
Donc au nom de sa « conception humaniste de l’éducation », N. Chomsky prévoit une école bien conçue, dans un environnement stimulant : « La conception humaniste de l’éducation, en effet, veut que l’on garantisse aux enfants l’environnement le plus riche et le plus stimulant qui soit, laissant libre cours à l’impulsion créatrice : une école bien conçue devrait en donner les moyens » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010, p.27).
Même s’il montre cependant comment il est difficile, en matière éducative, ce que Goodman et Illich ont à dire, lorsqu’il prend un exemple où l’un de ses amis proches, venu d’Europe à l’âge de quinze ans, s’était inscrit dans un lycée américain à New-York, et où d’emblée, il a été frappé de voir que, s’il arrivait à l’école avec trois minutes de retard, il devait se présenter devant le proviseur pour recevoir une sanction ; qu’en revanche, s’il ne faisait pas ses devoirs intelligemment, s’il n’était ni créatif ni original, il ne figurait pas au tableau d’honneur mais au moins il n’était pas convoqué dans le bureau du proviseur. Ponctualité et obéissance : telles étaient les valeurs qui devaient être inculquées. L’originalité ou le talent, c’était bien beau mais, à l’évidence, ce n’était pas primordial » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010, pp.27-28).
L’éducation est quelque chose de plus qu’existentiel pour un être humain, qu’on appelle enfant-élève. C’est ainsi que revenant sur l’une des thèses centrales de Dewey, selon laquelle « la production n’a pas pour but ultime de produire des marchandises, mais des hommes libres, associés les uns aux autres sur un pied d’égalité » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010, p.47), N. Chomsky estime établir un lien entre cette thèse de Dewey et sa principale thèse sur l’éducation, qui est sa grande préoccupation. Pour citer B. Russell, N. Chomsky considère que l’ « éducation a pour objectif de « donner aux choses une valeur autre que celle de domination, de former des citoyens avisés dans une société libre, de concilier citoyenneté et liberté, créativité individuelle, ce qui suppose de traiter l’enfant de la même façon qu’un jardinier traite une jeune pousse, dotée d’une nature propre, qui pourra éclore pleinement si on lui apporte le terreau, l’air et la lumière dont elle a besoin »( CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010,pp.41-42).
C’est ainsi « Malgré leurs différends sur bien d’autres sujets, Dewey et Russell s’accordent sur ce que ce dernier appelait la conception humaniste, issue des Lumières, selon laquelle l‘éducation ne consiste pas à remplir un contenant mais, bien plutôt, à accompagner l’éclosion d’une plante (en d’autres termes, à préparer le terrain où fleurira la créativité » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010, p.42). A telle enseigne que « Mises en application (ces idées directrices des Lumières et du libéralisme classique révolutionnaires), ces idées pourraient former des êtres libres, qui n’auraient pas pour valeurs l’accumulation et la domination, mais la libre association en termes d’égalité, de partage et de solidarité, et qui coopéreraient en vue d’objectifs communs et démocratiques » (CHOMSKY N., Pour une éducation humaniste, L’Herne, 2010,p.42).Vraisemblablement – que nous ayons récusé comme modèles, les théoriciens occidentaux de la philosophie – reste que ces développements amorcés par N. Chomsky sur l’éducation inspirés de Dewey et Russell, méritent d’être intégrées, combinés, mélangés à nos efforts pour l’élaboration d’une nouvelle citoyenneté négro-africaine et congolaise plus particulièrement.
S’agissant de la « quatrième antithèse », il s’agit de proposer une marxisation historique et matérialiste, une darwinisation originale et intégrale et une christianisation praxéologique à l’homme africain subsaharien pour son développement et sa transformation culturaliste, ontologique voire anthropologique comme une urgence impérative pour lutter avec plus d’efficacité, de détermination, combativité mais également et surtout avec davantage de dignité aussi bien contre l’impérialisme extérieur (euro-occidental) que l’impérialisme intérieur (exercé par les dictateurs au pouvoir en Afrique subsaharienne et en RDC en particulier). Enfin quant à la « cinquième et dernière antithèse »
Quant à la « cinquième et dernière antithèse », il s’agit de prôner la « fédéralisation de la République Démocratique du Congo (Etat-continental) comme un antidote structurel à la balkanisation à l’heure du temps ». Parce que nous sommes et restons convaincu que ce ne sont pas les hommes qui changent, développent et transforment la société, mais les idées, les mentalités culturelles et civilisationnelles ensemencées dans leur essence praxéologique. En effet, en panne épistémiquement et praxiquement, nous avons prôné et proposé à l’homme congolais dans son ensemble la thèse d’une réformation de l’Etat congolais passant du système électoraliste, du système unitariste-centraliste au système fédéraliste-éclaté(Nous avons, dans le journal La Prospérité, consacré à cette question portant sur la réforme de l’Etat plusieurs contributions), mais qui sont malheureusement demeuré, sans suite, bien au contraire au lieu de nous écouter, le pouvoir s’engage inopinément et aveuglement à la procédure conduisant à la révision constitutionnelle, bien alors qu’étant à la guerre, la priorité aurait été cette question sur cette réformation étatique.+, comme nous en avons développé dans une conférence-séminaire tenue pour le Master 1&2 de la faculté de philosophie de l’Université Catholique du Congo le jeudi 06 Juin 2024, intitulée « La pensée scientifique à la rescousse de la transformation mentale de la République Démocratique du Congo par la réformation de l’Etat du système électoraliste et centraliste-unitaire pour le système fédéraliste et éclaté».
Premièrement nous avons montré comment le système électoraliste fait d’organisations permanentes, récurrentes est la cause du sous-développement voire du blocage politique, économique, sociologique, technologique, civilisationnel, historique ; bref culturel » en république Démocratique du Congo. Comment ce système n’est rien de démocratique. Car ce ne sont pas toujours les élus proclamés qui le sont réellement.
Tout est joué d’avance. Les machines à voter sont instrumentalisées en fonction des élus du et au pouvoir, pour le besoin de la majorité absolue. L’ampleur de la contestation apportant de l’eau au moulin de son discrédit. Sur le système électoraliste, Laurent Mauduit dans son livre « Les imposteurs de l’économie », taillant et stigmatisant ceux qu’il appelle « Les agents doubles de la pensée unique », écrit : « D’Alain Minc à Jacques Attali, nous avons pu en prendre la mesure : cette OPA que la finance a faite sur le monde des économies, et, au-delà, le système de l’oligarchie française, produit nécessairement de la « pensée unique ». Le peut voter, la démocratie peut faire son œuvre … les mêmes survivent à toutes les alternances et enferment toutes les politiques économiques dans le « cercle de la raison ». Tout peut changer, mais rien ne change. C’est l’éternel commandement que nous avons déjà évoqué, celui de Tina ». « There is no alternative » … » (MAUDUIT L., « Les imposteurs de l’économie », Gawsewitch, 2012, p. 233).
Quant au premier type de forme d’Etat, l’unitarisme, le centralisme, notre argument est que le centralisme socio-politico-administratif est un argument pour la balkanisation de la république Démocratique du Congo. Parce que la concentration de l’Etat dans la capitale Kinshasa ne peut aider le Congo à aller de l’avant.
Car bien que le centralisme soit la forme la plus courante dans la plupart des pays, cette forme de l’Etat ne convient pas à la République Démocratique du Congo au regard de son immensité. Enfin quant au second type d’Etat, le fédéralisme, il est dans la situation actuelle de la République Démocratique du Congo, le seul qui est un antidote efficace contre la balkanisation. Le pouvoir doit réformer l’Etat et passer au système fédéral ou éclaté.
En tout cas malgré des failles voire manques propres à n’importe quel système politique, avec le fédéralisme ou la forme de l’Etat éclaté, le pouvoir congolais sera omniscient et omnipotent, c’est-à-dire présent partout et nulle part ailleurs au même moment.
- Pour conclure sans conclure
La présentation et le développement des cinq antithèses pour et contre la thèse du Pape François et sa réappropriation « inappropriée », n’avait qu’un seul objectif défendre le Saint Père François dont la déclaration et a été globalement mésinterprétée, mécomprise, déformée eu égard à sa véritable essence et intention. Une mésinterprétation foncièrement contre-productive dans le contexte du développement et de transformation général, total et global de la République Démocratique du Congo et de l’Afrique subsaharienne en général.
Il nous faut bien comprendre et intégrer que nos antithèses sont pour la paix et donc absolument positives, dans la mesure où quoiqu’en faisant l’éloge de la guerre, notre démarche prêche la paix, en même temps qu’elle vénère la guerre comme cette porte-là qui nous conduit à la paix et vice-versa de la paix à la guerre, et donc en la faveur de cette dialectique qui tend et sous-tend le survit destinal de l’humanité.
Les Etats-Unis d’Amérique, la tête de pont de l’OTAN, de l’UE, de l’ONU et du TPI ont horreur des grands espaces. La guerre Russie-Ukraine est la résultante d’une telle hantise. C’est la Troisième Guerre Mondiale. Mais qui ne dit pas son mot. Sous l’Administration démocrate Clinton, les USA ont activé la théorie du domino. Cette théorie s’appelle également le Basculement. L’ex-Yougoslavie en a fait les frais. Le Sud-Soudan en est la résultante africaine. Or si nous continuons à ignorer le savoir et à mépriser le temps, la RDC n’y échappera pas.
Quant aux « charlatans de la démesure », ils devaient se ressaisir pour réorienter la gouvernance du président de la République.
Cette réorientation c’est sur la réformation de l’Etat congolais, plutôt que sur la révision constitutionnelle ou sur un énième dialogue inter-congolais. Parce que ce n’est nullement la révision ou la modification des certains articles de la Constitution, qui empêcheront la balkanisation, mais au contraire la maîtrise du temps, le savoir, l’épistémisation et la praxisation de cette gouvernance. « Le philosophe grec Zénon d’Elée, note A. Toffler, affirmait que si un voyageur parcourait chaque jour la moitié du chemin qui le séparait de sa destination finale, il ne pourrait jamais parcourir y parvenir puisqu’il lui resterait toujours une moitié à couvrir.
Semblablement, il se peut que nous n’atteignions jamais au savoir ultime sur aucun sujet, mais nous pouvons toujours faire un pas de plus, qui nous rapprochera d’une compréhension complète.
En principe du moins, le savoir est indéfiniment extensible (TOFFLER A., Les Nouveaux pouvoirs, Fayard, 1991, p. 38).
Des propos, soit dit en passant, à eux seuls, qui mettent en lumière les enjeux du dialogue Nord-Sud et le rapport des forces entre les pays riches et les pays pauvres, mieux l’Occident officiel chrétien et le SUD GLOBAL. C’est là qu’il va falloir aux charlatans de la démesure de changer de métier pour devenir épistémiques, réfléchis, praxiques plutôt que flambeurs, nuitards, danseurs absolutistes.
Ce rapport des forces avec l’Occident est dans le savoir, qu’Africains subsahariens et Congolais devaient d’atteindre pour sauver leur pays de la balkanisation ou du moins éteindre ses racines. Incompétent complet et absurde, personne ne peut crier à l’injustice, concernant l’homme congolais. Et encore moins de parler de non-assistance en personne en danger. Il n’est pas en danger. Il vit dans la jouvence et dans l’insouciance. Tous les matins et soirs, las bars, les supers marchés, les églisettes sont bondés. Et tous souriants qu’il pleuve ou fasse chaud. La guerre à l’est du pays ne le préoccupe nullement. D’autres s’en chargeront. Le Pape François précisément. Il pourra parler à sa place.
Pendant ce temps-là, lui, il se la coulent tout doucement. Voilà l’esprit congolais et négro-africain en général : le Corps au détriment de l’Esprit. L’africain noir entretient le Corps. Quand l’Européen s’occupe de son Esprit. En cela il n’y a pas de miracle que l’un (le Noir) pourrisse, meurt pauvrement, tristement et que l’autre (le Blanc) s’y éternise, se développe et développe, se transforme et transforme, se crée et se recrée, se produise et se reproduise, s’y invente et s’y réinvente.
C’est pourquoi s’il arrivait que nous échouions dans notre tentative de déconstruire une citoyenneté congolaise plus exemplaire du développement et de transformation, nous proposons d’ores et déjà deux pistes de solution consistant premièrement à amorcer une procédure de recrutement des populations éparses et venant de toute part qu’elles soient blanches, jaunes, rouges, noires pour venir soit remplacer l’homme congolais actuel, incompétent complet, soit cohabiter avec lui pour lui apprendre les vertus de la création, de la production et de l’invention dans l’Histoire, pour le développement et la transformation d’un espace géographique, qu’on appelle un pays, un Etat, une nation; deuxièmement en la faveur d’un processus médicalisé, en ce compris les manipulations et mélanges génétiques d’ordre anatomico-biologique pouvant donner naissance d’un côté à un autre type d’homme congolais mieux éduqué, instruit, intelligent, épistémique, réflexif, rationnel et d’un autre côté moralement, éthiquement, mieux, praxéologiquement conséquent, humainement humanisant, et enfin, troisièmement par la voie juridico-administrative par la naturalisation ou l’adoption promouvoir un type d’homme adapté aux exigences d’une société moderne en mouvement sans cesse.
Conférence prononcée à L‘occasion des Vingt-huitièmes Journées Scientifiques de l’USAKIN, le jeudi 19 janvier 2025
Antoine-Dover OSONGO-LUKADI
-Habilité à Diriger des Recherches de Philosophie
(Université de Poitiers-France)
-Docteur en Philosophie et Lettres
(Université Catholique de Louvain-Belgique)
-Professeurs d’Universités
-Membre Association des Philosophes Américains (APA)

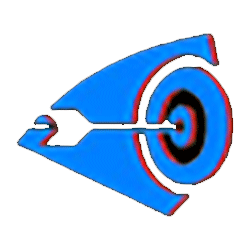
 Fr
Fr 

