Sanction du jury : ‘’Grande distinction’’ IFASIC : Adelard Obul Okwess a défendu avec brio son mémoire de DEA !

Le chef des Travaux Adelard Obul Okwess a défendu publiquement, samedi 23 septembre, à l’Institut facultaire des Sciences de l’information et de la communication (Ifasic), à Kinshasa, son mémoire d’études approfondies, avec comme sujet de recherche : « Les radio-tableaux dans les paroisses catholiques de Kinshasa. Approche de la sémiotique cognitive ». Dans cette recherche, le récipiendaire montre que la radio-tableau ne saurait être examiné sous l’angle d’un simple phénomène d’information, relevant de l’ordinaire du journalisme.
Cinq Professeurs ont composé le jury avec à la présidence, le Professeur émérite François-Xavier Bundim’bani et au secrétariat, son homologue, le Professeur Paul Massey ; le Professeur Jean-Chrétien Ekambo Duasenge, a été là en sa qualité de promoteur du travail, pendant que les deux autres : Professeur ordinaire Eddie Tambwe Kitenge et Professeur Fidèle Makiese, ont joué leur rôle au même titre que les trois autres comme membres ordinaires du jury.
Dans l’économie de sa recherche, Adelard Obul Okwess a, en premier lieu, salué et remercié très respectueusement professeurs, étudiants, amis et connaissances qui ont accepté de prendre part à cette séance académique. A cette même occasion, il a présenté sa reconnaissance à l’ensemble du département du troisième cycle pour la qualité du travail abattu au courant de ces longues années de son encadrement. Dans la foulée, il a exprimé sa gratitude à l’endroit de son comité d’encadrement, et en particulier à son Directeur, le Professeur émérite Jean-Chrétien Ekambo, pour sa rigueur et sa sollicitude. Avant de mettre un terme à cette étape protocolaire, il n’a pas oublié de marquer sa gratitude à titre posthume au Feu professeur Aimé Kayembe Tshibamba Malu, qui a quitté récemment le monde des vivants, pour sa contribution significative à l’avancement de son étude.
En effet, il a laissé entendre que cette recherche est partie d’une considération épistémologique précise, selon laquelle les instruments de communication ne devraient plus être vus comme de simples canaux physiques de transmission des contenus, mais bien comme des lieux de médiation sociale. C’est dans cette linéarité logique qu’il reconnait ne pas être le pionnier dans cette piste. «Certes, la médiation est plus complexe, mais Dominique Wolton indique que, dans le un-quart du temps, la communication c’est avant tout la médiation et la négociation», a-t-il affirmé.
Sur le plan scientifique, il a indiqué que cette étude présente un phénomène certes singulier, mais qui met en évidence trois logiques : celle de la production des contenus affichés (oral et écrit), celle de leur décryptage (le passage de l’oral vers l’écrit), et enfin celle de leur consommation (oral-écrit-oral).
Sur le plan pratique, Obul Okwess a fait savoir qu’il avait voulu comprendre comment une communauté se forge une culture informationnelle localisée à travers les travaux, et se pose comme question : pourquoi l’une avant l’autre ?
Ainsi, il a estimé que le premier débat est donc d’ordre onomastique (sic). Pourquoi radio et pourquoi tableau ? Pourquoi pas l’un sans l’autre ? Et pourquoi l’une sans l’autre ?
« Cette terminologie n’est pas fabriquée par nous. Nous n’avons fait qu’adopter cette appellation de « Radio-tableau » proposée par l’écrivain Yoka Lye Mudaba. Nous ne pouvons déterminer comment cette inspiration s’est imposée à cet auteur bien connu des chroniques littéraires », a-t-il dit. Et de renchérir : « toutefois, la présence concomitante et complémentaire de deux modalités communicationnelles : l’oral et l’écrit, n’est pas du tout sans intérêt. En effet, d’autres pratiques de ce genre ont déjà précédé, à savoir : Radio-trottoir, communication radiorale ou encore parlement-debout ».
Selon lui, tous ces néologismes ont été étudiés scientifiquement et des thèses de doctorat leur ont déjà été consacrées. Quant à la radio-tableau, elle s’est offerte à nos yeux comme un tableau d’affichage ordinaire sur lequel sont mentionnées des informations d’ordre divers. Tableau alors fixé dans les paroisses catholiques, vraisemblablement sous leur responsabilité, même si les contenus ne portent pas spécifiquement la signature de leurs rédacteurs.
Hormis l’introduction et la conclusion générales, cette présente recherche comporte deux parties essentielles. La première s’est consacrée à la construction de l’idéal-type. Le premier chapitre porte sur l’analyse conceptuelle de la Radio-tableau. Le deuxième met en exergue la communauté ecclésiaste, identifiée ici comme communauté d’écriture informationnelle. Le troisième présente le cadre théorique de cette étude, basé sur la sémiologie cognitive et la théorie de l’implicature de Paul Herbert Grice.
Ce qui nous amène à la seconde partie de l’étude qui s’attèle à l’analyse du corpus constitué après une récolte des données de terrain. Cette seconde partie commence par le quatrième chapitre qui présente la monographie des radio-tableaux dans l’espace diocésain de Kinshasa. Vient enfin le cinquième et dernier chapitre consacré à l’analyse inférentielle des items.
En définitive, Adelard Obul Okwess a fait savoir que, contrairement à la pratique journalistique où l’interlocuteur ne vient que consommer le contenu produit par le locuteur-émetteur, la théorie de l’implicature induit que toute communication a une visée coopérative. L’interlocuteur ne consomme pas passivement le contenu qui lui est proposé, mais il participe à la construction d’un second sens commun qui est partagé. L’impétrant qui ajoute : « le deuxième apport de cette recherche est la relation entre le journalisme et les sciences cognitives ».
Il sied de signaler que, après le huis clos, les membres ayant composé le jury académique du jour ont transmis publiquement leur décision, tant attendue par tous, celle d’avoir reçu avec considération le mémoire de DEA du chef des Travaux Adelard Obul Okwess. La délibération qui a fait suite aux débats ont valu à l’homme du jour la mention grande distinction, avec comme expression numérique de la valeur de son travail : 17 sur 20.
Hénoc Akano & Saint-Germain Ebengo

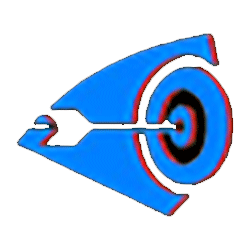



Comments est propulsé par CComment