ESG, la paix et la légitimité aux conditions de l’Afrique

(Par Christopher Burke, Conseiller principal, WMC Africa)
L’Afrique alimente la transition énergétique mondiale. Le cuivre, le cobalt, le manganèse, le graphite, le lithium et les terres rares issus des sols africains se retrouvent dans les batteries, les éoliennes et les lignes de transport d’électricité qui façonneront la prochaine ère industrielle. Derrière ces manchettes se cache une réalité plus discrète : les règles qui déterminent comment ces minerais sont extraits, vérifiés et échangés sont pour l’essentiel écrites hors du continent, appliquées de manière inégale et le moins bien comprises par celles et ceux qui vivent au plus près des mines. Ce n’est pas un débat sémantique ; il s’agit de savoir qui supporte les coûts, qui capte la valeur et si la gouvernance attise les griefs ou renforce la paix.
Tirer parti des règles « vertes »
Les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont conçues pour prévenir les préjudices. Dans les faits, elles déterminent aussi qui accède aux marchés et à quelles conditions. Les règles européennes en matière de diligence raisonnable et de lutte contre la déforestation imposent des exigences de données et de conformité que de nombreux producteurs africains peinent à satisfaire dans les délais impartis. Le « friend-shoring » américain (relocalisation chez les alliés) lie une partie des incitations liées aux technologies propres à des alignements géopolitiques qui reconfigurent les partenariats admissibles, indépendamment de performances similaires sur le terrain. La Chine, de plus en plus, associe financements et infrastructures à un habillage « vert » promettant des projets de haute qualité, tout en ancrant souvent une dépendance durable aux matières premières. Chaque approche se comprend du point de vue de son initiateur. Pris ensemble, l’effet net est un corpus de règles chargé, évoluant rapidement et rarement co-construit avec les acteurs africains.
Perspectives de terrain
Il existe fréquemment un écart entre les images vues à la télévision et la réalité vécue sur le terrain. Là où la présence de l’État est inégale et l’autorité fragmentée, des recommandations conçues pour une administration unitaire et bien dotée ont peu de prise. Les cours d’eau sont souvent très pollués après les pluies, la poussière stagne au-dessus de nombreuses cités minières et les projets sociaux arrivent tard ou n’aboutissent pas. La confiance s’érode vite lorsque des entreprises affirment respecter des normes lointaines alors que les impacts locaux demeurent sans réponse. Dans les zones fragiles, cette perte de confiance devient un risque sécuritaire : les différends se durcissent, les « spoilers » recrutent plus aisément et le contrat social s’effiloche. Les enjeux ne sont pas seulement réputationnels ; ils sont politiques.
Les défis de la fragmentation
La superposition de régimes — directives européennes de durabilité, règles d’aides américaines, cadres de partenariat chinois et schémas sectoriels — ouvre la voie au shopping ESG. Les entreprises optent pour la voie de conformité la plus simple plutôt que pour celle qui maximise les bénéfices pour les citoyens africains. Ministères, régulateurs et producteurs consacrent un temps rare à réconcilier des modèles contradictoires au lieu d’améliorer les résultats. Les coûts de transaction augmentent et la redevabilité se brouille. Lorsque la vérification repose sur l’auto-déclaration des entreprises et des audits privés aux méthodologies variables, « responsable » devient une étiquette à obtenir plutôt qu’une performance à démontrer.
L’angle mort de l’ASM
L’exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE/ASM) est centrale pour les moyens de subsistance dans de nombreuses zones. Difficile à auditer, elle est régulièrement exclue des récits de « l’approvisionnement responsable ». Le risque ne disparaît pas pour autant ; il est simplement déplacé. La matière continue de transiter via des intermédiaires, les dangers restent non traités et des possibilités d’emplois plus sûrs et formels sont manquées. Ignorer l’ASM affaiblit aussi la qualité des données : une large part de ce qui se passe réellement autour des sites miniers n’apparaît jamais sur les tableaux de bord officiels. Traiter l’ASM comme périphérique revient à gouverner une fiction ; et gouverner des fictions finit rarement bien.
Écoblanchiment et auto-déclaration
Les rapports de durabilité mettent souvent en avant les politiques adoptées plutôt que les impacts obtenus. Les périmètres d’audit varient. La traçabilité peut s’arrêter au niveau des fonderies, bien après la survenance d’atteintes communautaires. Sans données ouvertes et vérification indépendante que toutes les parties prenantes — en particulier les communautés — peuvent consulter et éprouver, les allégations de « minéraux responsables » relèvent surtout des relations publiques. La légitimité en pâtit lorsque les dispositifs se révèlent poreux, surtout là où les citoyens perçoivent déjà l’État comme distant ou fragmenté et s’en remettent à des institutions locales ou non étatiques pour résoudre les problèmes quotidiens.
Pouvoir de négociation et « règles du jeu » mouvantes
Des standards fixés hors d’Afrique sont difficiles à mettre en œuvre, a fortiori à maintenir. De nouvelles obligations de divulgation peuvent surgir en cours de contrat, des critères d’éligibilité peuvent reconfigurer les marchés du jour au lendemain et des relèvements de certification peuvent dépasser les investissements de conformité récents. Ce sont d’abord les administrations provinciales et les acteurs au niveau des sites qui encaissent ces chocs, non les instances qui écrivent et modifient les règles. Les producteurs dépendant d’un seul corridor d’exportation ou d’un seul acheteur ont peu de marge pour négocier un étalement ou un appui. Il en résulte une incertitude chronique qui décourage les investissements de long terme dans la montée en gamme locale, les compétences et la réhabilitation environnementale — précisément ce que l’ESG était censé favoriser.
Paix et légitimité en jeu
Réduire l’ESG à un exercice de conformité étroit fait manquer l’essentiel. Là où les capacités étatiques sont minces et les transitions politiques fragiles, la gouvernance des richesses minières est indissociable de la paix. Quand les communautés vivent l’ESG comme une vitrine — des labels sans remède — les griefs s’approfondissent et les fauteurs de troubles en tirent avantage. La confiance se construit lorsque les citoyens voient des contrats rendus publics, des engagements tenus, des griefs réglés dans des délais clairs et des données indépendantes en accord avec leur vécu. En Afrique, l’ESG n’est pas seulement une question technique pour investisseurs ; c’est une question de légitimité.
Pistes de travail
Pour réduire les dommages et la confusion, le temps qu’une réponse africaine plus complète se précise, il est utile de publier les règles, pas seulement les rapports : adopter un modèle public commun couvrant contrats, redevances, paiements communautaires et issue des griefs, en mobilisant les outils et instruments déjà disponibles — la Vision minière pour l’Afrique (AMV), les orientations du Centre africain de développement des ressources minérales (AMDC), le Code panafricain de déclaration des ressources (PARC) et l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) —, le tout rassemblé dans un dossier unique et un tableau de bord public.
Il est tout aussi important de vérifier l’essentiel en remplaçant l’auto-déclaration par des audits indépendants et une validation locale, afin que les communautés puissent voir, tester et contester les allégations, tout en faisant entrer l’ASM dans la lumière grâce à l’enregistrement, à un appui de base en sécurité et à une traçabilité à faible coût au point de vente. L’objectif doit être la clarté, la réduction de la fragmentation et la baisse des coûts de conformité, en s’appuyant sur les institutions africaines existantes — Centre africain de développement des ressources minérales (AMDC), Organisation africaine de normalisation (ARSO) et Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf/AfCFTA) — pour aligner les demandes de divulgation et de vérification et négocier la reconnaissance mutuelle avec les régimes externes. Il n’est pas nécessaire d’alourdir la bureaucratie avec une couche supplémentaire de gouvernance.
Il s’agit d’un instantané, non d’un plan détaillé. L’objectif ici est d’éclairer les pressions telles qu’elles sont. Les défis centraux sautent aux yeux : des règles écrites ailleurs ; une vérification qui récompense le papier plutôt que la performance ; une ASM souvent ignorée ; une auto-déclaration propice à l’écoblanchiment ; un pouvoir de négociation érodé par des règles du jeu mouvantes.
L’Afrique peut continuer à courir derrière ou nommer clairement ces pressions, mobiliser les outils déjà à sa disposition et se préparer à fixer les termes. La transition énergétique repose sur les minerais africains ; ce fait crée un levier. Transformer ce levier en légitimité commence par un diagnostic clair, pas par un slogan de plus.
FIN

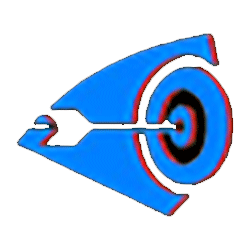



Comments est propulsé par CComment