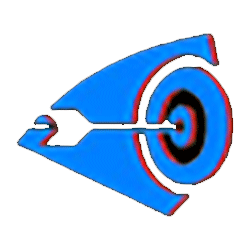Louis Aragon disait : la femme est l’avenir de l’homme. Si cette citation du poète demeure une vérité irréfragable en raison du fait que, millénaire après millénaire, c’est la femme qui se charge de perpétuer l’espèce humaine, il est aussi vrai que, de nos jours, lorsqu’une femme est placée à un poste de responsabilité, elle arrive à influer, de manière significative, sur l’avenir de sa communauté. C’est ce que révèle l’œuvre qu’accomplit, une femme à la tête du secteur de Lufupa, dans le territoire de Mutshatsha en province du Lualaba. En effet, désignée à ce poste voici un peu plus deux ans par la Gouverneure Fifi Masuka Saini, Mme Laetitia Kalukangu Nawezi est en train 0de porter un cinglant démenti à un vieux dicton de chez nous qui insinue que « Muasi akoki kotonga mboka te ».
Lors de son entrée en fonction en septembre 2023 comme Cheffe de secteur, Mme Laëtitia hérita de nombreux chantiers inachevés laissés par son prédécesseur et qu’elle devait relancer au nom de la continuité de l’Etat. Une fois au travail, Mme Laëtitia se révèlera être une véritable « Mpanda Njila » en ce que, les sentiers d’hier ont été transformés en routes dont 220 kms de routes de desserte agricole ou reliant les différents groupements et villages du secteur, avec une bonne partie d’entre elles asphaltée. Au plan social, Musokantanda et Mushima, les deux groupements qui composent le secteur de Lufupa ont été pourvus des écoles équipées par l’autorité du secteur, tandis que les localités de Kabundji, Mulumbe, Kaleji, Mapendo et Kisote ont été dotés chacune d’un centre de santé entièrement équipé. Dans un autre registre, 90 forages d’eau repartis dans Musokantanda et Mushima ont été réalisés, pendant que deux systèmes d’adduction d’eau potable étaient mis en œuvre à Musokantanda au profit de 100.000 ménages. La localité de Tshipaya est aussi dotée du même système d’adduction d’eau avec une capacité similaire. Aucun domaine n’étant oublié, LUFUPA est doté d’un bâtiment administratif de type R+1, d’un Guest House moderne, d’une maison de passage, de deux centres de négoce, de deux marchés modernes déjà opérationnels pouvant accueillir plus de 300 vendeurs
Voici le mais made in Lufupa
L’ex-Grand Katanga est connu pour avoir comme aliment de base le maïs, aliment qui est consommé par près de 95% de sa population. Consciente du déficit chronique de cette denrée sur l’ensemble du pays, déficit qui fait que des devises lourdes sont consacrées chaque année à son importation, Mme Laetitia Kalukangu a tenu à faire de l’agriculture l’un des moteurs du développement de son entité. Ainsi, un programme agricole ciblant principalement le mais a été mis en œuvre, à travers plusieurs hectares de terre qui ont été emblavés. Aujourd’hui, le secteur de LUFUPA est fier de mettre à la disposition des habitants de Kolwezi et de ses environs la farine de maïs de même qualité que celle importée à la différence que le sac de 25 kilos est vendu à 30.000 francs congolais contre 40.000 pour la farine importée. Au vu du succès de cette première expérience, Mme Laetitia Kalukangu compte passer à la vitesse supérieure en visant 500 hectares à emblaver au cours de l’année 2026.
Nous pouvons donc dire, et cela, toute modestie mise à part, que si l’expérience agricole du secteur de Lufupa, venait à être dupliquée dans d’autres entités, le déficit en mais de la province du Lualaba serait en train de vivre ses derniers jours.
Victor Kalenga Nsana/CP