Ma compréhension sur la Déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda
(Par Kasongo-Numbi Kashemukunda)
Après la lecture de la Déclaration du 25 avril 2025 signée à Washington par les deux ministres des Affaires Etrangères de la RDC et du Rwanda, on peut soit penser que la Déclaration se contredit ou qu’elle ne se contredit pas.
On pense que la Déclaration se contredit quand on conclut qu’après avoir affirmé, en son point 1, le respect des frontières de chaque pays et surtout de sa souveraineté sur son territoire, elle laisse entendre, en son point 3, que les deux pays vont cogérer leurs ressources naturelles où qu’elles se situent sur le territoire de l’un d’eux.
On pense que la Déclaration ne se contredit pas quand on conclut que chaque pays gère souverainement seul les ressources naturelles qui sont sur son territoire mais les deux pays coopèrent (coopérer est le mot qui est utilisé dans la Déclaration et non cogérer) uniquement sur la mise en valeurs des ressources naturelles qui les rassemblent.
Je suis de ceux qui disent que ladite Déclaration ne se contredit pas. Je soumets ici, à l’appréciation de chacun, l’argumentaire qui soutient ma compréhension de ladite Déclaration.
Quelles sont ces ressources qui rassemblent physiquement les deux pays ? Ce sont évidemment celles qui sont frontalières. Or il y en a.
En ce qui concerne le domaine de l’hydroélectricité, nous avons deux centrales sur la rivière Ruzizi (centrales de Ruzizi 1 et Ruzizi 2) et une autre encore au niveau des études de faisabilité (la centrale de Ruzizi 3). Ces trois centrales rassemblent nos trois pays (Burundi, RDC et Rwanda) car elles sont construites sur la Ruzizi qui forme la frontière entre la RDC et les deux autres pays. Elles sont ainsi cogérées dans le cadre la CEPGL à travers une société commune que les trois pays qu’elles rassemblent ont créé le 20 août 1974, Electricité de la Région des Grands Lacs, (EGL). Dans la convention créant cette société, le DG est obligatoirement un Congolais, le poste de DGA est confié au Rwanda et le Siège est placé à Bujumbura au Burundi. En 2013, j’ai été envoyé à Kigali, puis à Bujumbura, comme expert, par notre ministre de l’environnement de l’époque, Monsieur Bavon N'Sa Mputu, pour valider, avec les experts de deux autres pays, une étude de faisabilité effectuée par un bureau d’étude italien sous financement de la Banque Africaine de Développement. L’EGL est, dans la région où sévit aujourd’hui la guerre, ce qu’est la Snel dans le reste du pays. Elle est mise en mal par la guerre. Il est donc normal que la Déclaration demande une coopération saine et pacifique de ces trois centrales. On se rappelle, d’ailleurs, que quand l’AFDL avait occupé la région de la rivière Ruzizi en 1996, elle s’était empressée de couper le courant électrique à la partie congolaise (zaïroise à l’époque) qui bénéficie du courant électrique de deux centrales (Ruzizi 1 et 2). En outre, tout le monde sait que les animaux qui vivent dans des parcs frontaliers se déplacent librement d’un pays à l’autre sans demander des visas. On sait aussi que le gaz méthane qui est dans le fond du lac Kivu s’étend de part et d’autre de la frontière entre la RDC et le Rwanda et ne se déplace vers les pompes situées dans les deux pays qu’en obéissant aux lois physiques et non aux lois juridiques. Quant aux ressources minérales déjà découvertes et à découvrir dans cette région frontalière, elles peuvent bien se situer de part et d’autre de la frontière ou à sa proximité. On comprend, dès lors, que leur mise en valeur demande une coopération apaisée dans la paix.
J’ai des difficultés à comprendre la lecture du point 4 de la partie 3 de la Déclaration qui porte sur le « Cadre d’Intégration Economique Régionale » que font certaines personnes en l’opposant à la partie 1 qui traite de « la Souveraineté, l’Intégrité Territoriale et la Gouvernance de deux pays ». Pourtant le point 4 précise que la coopération sur la mise en valeur des ressources naturelles ne concerne que celles qui rassemblent les deux pays ! Pour moi, les centrales hydroélectriques d’Inga, de Mobayi Mbongo, de Katende, de Kakobola, etc. tout comme les gisements miniers du Katanga, du Kasaï et d’autres régions non frontalières, ainsi que les forêts de la Tshuapa, toutes ces ressources naturelles éloignées de la frontière, donc qui ne rassemblent pas les deux pays, soient concernés par la mise en valeur conjointe entre la RDC et le Rwanda.
Parmi ceux qui, à mes yeux, font une mauvaise lecture de la Déclaration du 25 avril 2025, vont jusqu’à dire que la coopération sur la mise en valeur de ces ressources qui rassemblent nos deux pays (frontalières) hypothèque la souveraineté de la RDC. Pourtant, depuis le 20 août 1974, donc depuis plus d’un demi-siècle, que l’EGL (Electricité de la Région des Grands Lacs) est créée et cogérée par les trois pays (Burundi, RDC et Rwanda) ces lecteurs n’ont jamais dit que cette gestion commune hypothèque la souveraineté de notre pays. Ladite Déclaration n’a pas créé cette cogestion des ressources naturelles frontalières qui existe depuis la naissance de nos trois pays, elle la confirme seulement.
Voilà ma lecture de la Déclaration des ministres des Affaires Etrangères de la RDC et du Rwanda, le 25 avril 2025, à Washington.
Je crois que je dois profiter de ce moment pour informer ceux qui ne le savent pas encore et rappeler à ceux qui le savent déjà que la stratégie de confier les concessions des ressources naturelles du Congo aux sociétés privées contre la protection des frontières du pays avait commencé dès le lendemain de la clôture de la Conférence de Berlin de 1885 avec le roi Léopold 2, alors souverain du Congo, par la création des sociétés à charte. Quand il a cédé le Congo à la Belgique en 1908, les colonisateurs belges avaient repris la même stratégie et l’ont même renforcée.
L’I.A. informe : «Les sociétés à charte ont joué ainsi un rôle fondamental dans la protection de l'intégrité territoriale du Congo belge. Elles ont agi comme des instruments d'administration directe, de répression des résistances internes, et de protection contre les menaces extérieures. En utilisant la Force Publique, en exploitant des ressources stratégiques, en construisant des infrastructures, et en exerçant des pouvoirs judiciaires et militaires, elles ont permis à Léopold II de maintenir son autorité sur le territoire. Cependant, cela a été réalisé au prix de pratiques brutales, de violations des droits humains et d'une exploitation inhumaine des populations congolaises».
Donc ce que le gouvernement voudrait faire avec les Américains en leur donnant des concessions d’exploitation des ressources naturelles contre leur participation à la sécurisation de l’intégrité du territoire de notre pays et de notre souveraineté est la stratégie qui avait permis à la Belgique, un petit pays, de garder le Congo belge contre la convoitise de grandes puissances qui contrôlaient les colonies voisines. Nous avons eu tort d’abandonner cette politique après l’indépendance ; voilà où cette inconscience nous a amenés. Tous les pays du monde le font. On ne donne rien pour rien comme nous l’avons fait depuis le 30 juin 1960. En ce moment même, l’Ukraine est en train de le faire avec les mêmes Etats-Unis d’Amérique grâce à ses minerais stratégiques.
Voici une liste de quelques sociétés à charte créées par Léopold II et maintenues dans leurs rôles par la colonisation belge.
1. La Société Anonyme du Haut-Congo (S.A.H.C.)
- Création : En 1887.
2. La Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie (CCCI)
- Création : En 1888.
3. La Compagnie du Congo Français (CCF)
- Création : En 1894.
4. La Compagnie du Katanga
- Création : En 1906.
5. La Société Royale du Congo belge (Société Générale de Belgique)
- Création : Bien que fondée avant la période de Léopold II, cette société a joué un rôle important dans l'exploitation des ressources du Congo.
6. La Compagnie de l'État Indépendant du Congo (EIC)
- Création : Avant la création de l'État belge au Congo, Léopold II a fondé l'État Indépendant du Congo en 1885, une entité privée placée sous son contrôle personnel. Il a utilisé différentes sociétés à charte pour exploiter les ressources.
7. La Compagnie du Congo belge (Société Générale du Congo)
- Création : Cette société a été formée après la cession du Congo par Léopold II à l'État belge en 1908.
Les documents, ci-après, démontrent que les sociétés à charte n'étaient pas seulement des entités économiques, mais qu'elles jouaient également un rôle dans l'administration et le contrôle militaire du territoire congolais, en étroite collaboration avec la Force Publique.
8. La Compagnie des Chemins de Fer du Congo (CFR)
- Création : Fondée dans les années 1890, cette société était chargée de construire et de gérer les lignes de chemin de fer qui permettaient le transport des matières premières extraites, telles que le caoutchouc et le minerai de cuivre, vers les ports.
Pour des chercheurs sur le sujet, l’Intelligence Artificielle qui m’a fourni les noms de quelques sociétés à charte m’a aussi fourni la liste ci-dessous de documents que l’on peut consulter pour des informations plus détaillées sur le rôle des sociétés à charte au Congo pendant l’époque belge dans notre pays.
1. La Force Publique de sa naissance à 1914
Cet ouvrage, réalisé par la deuxième section de l'État-major de la Force Publique et publié par l'Institut Royal Colonial Belge en 1952, offre une analyse détaillée de la création et du développement de la Force Publique. Il met en lumière la participation des militaires à l'histoire des premières années du Congo, notamment en lien avec les sociétés à charte.
2. Memoire Online - L'armée dans la stabilisation politique d'un État : cas de la RDC
Cette étude souligne que la Force Publique a été officiellement mentionnée pour la première fois dans le décret du 30 octobre 1885, définissant la structure du gouvernement de l'EIC. Elle avait pour attributions l'occupation et la défense du territoire, le maintien de la sécurité, et l'exécution des lois, décrets et règlements. La création de la Force Publique est donc directement liée aux structures mises en place par Léopold II et les sociétés à charte.
3. La « Force Publique », institution coloniale belgo-congolaise
Un article qui décrit la Force Publique comme une institution créée en 1885 par Camille-Aimé Coquilhat, sur ordre du roi Léopold II. La Force Publique servait de police nationale et de répression contre les populations locales, contrôlant la production de ressources telles que l'ivoire et le caoutchouc, souvent en collaboration avec les sociétés à charte.
4. Force Publique - Mémoires de Guerre
Ce site fournit des informations sur l'organisation et les missions de la Force Publique, soulignant les problèmes de discipline et les abus de pouvoir de certains officiers. Il mentionne également la collaboration entre la Force Publique et les compagnies privées dans l'administration du territoire.
Fait à Kinshasa, le 01 mai 2025
KASONGO-NUMBI Kashemukunda
Tel +243814730609

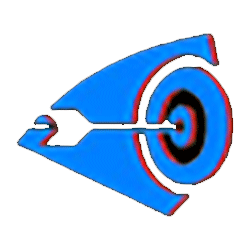



Comments est propulsé par CComment