De Mudimbe à ses disciples : de la critique à la créativité !
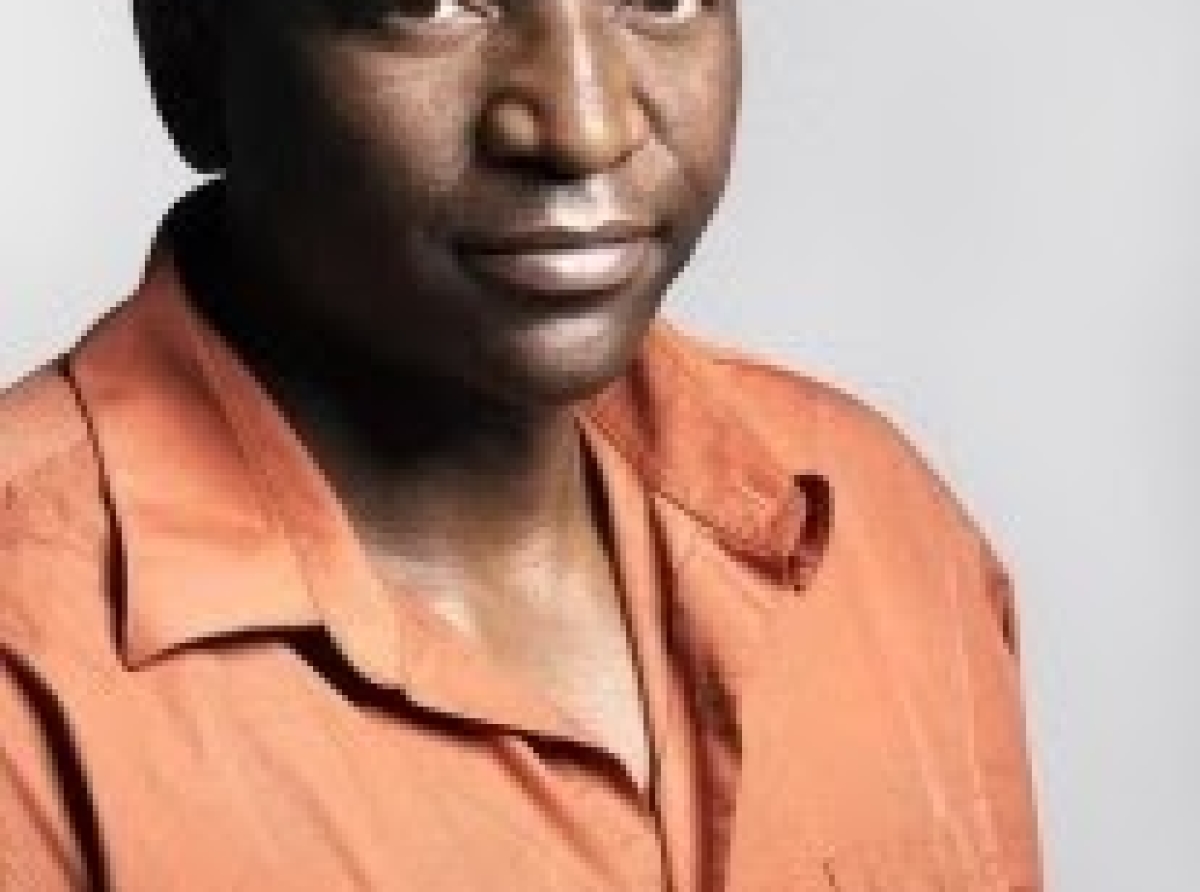
(Par le Professeur Patience Kabamba)
Le weekend d’aujourd’hui a connu un embouteillage monstre quant au sujet à traiter pour le MDW. La disparition du pape François le lundi de Pâques était au rendez-vous. Deux personnes m’avaient contacté particulièrement pour me demander de parler dans le MDW d’aujourd’hui du comportement économique des Congolais et aussi des leçons que le Congolais tirent de la guerre qui sévit dans la partie orientale de notre pays. Nous avons finalement pris la décision de plancher sur le savant congolais Vincent Yves Mudimbe tout en rendant un hommage distingué à la figure du pape François dont le pontificat était marqué par une simplicité désarmante. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs de l’Est qui vivent une situation de guerre privatrice des libertés politiques et économiques. La prochaine fois, nous débattrons de la liberté de l’économie et de l’économie de la liberté en temps de guerre dans notre pays.
Le Professeur Mudimbe s’est aussi éteint durant l’octave pascale en ce 22ᵉ jour du mois d’avril 2025 à 83 ans. J’aimerais présenter ce qui a rendu Mudimbe très connu dans le monde scientifique, son impact sur la compréhension de l’Afrique et enfin la contribution de ses disciples au déclin ou au rayonnement de la République démocratique du Congo.
Quelle est la responsabilité du maître lorsque les disciples sont complètement noyés dans un cadre politique dont il a lui-même jugé bon de se départir ?
Dans son ouvrage majeur qui l’a fait connaitre dans le monde et qui était publié en anglais – The Invention of Africa –Mudimbe a montré une intuition plutôt exceptionnelle par rapport à sa confrontation au colonialisme dans lequel il est né et pendant lequel il vécut.
La plupart des intellectuels africains aborde l’héritage colonial en faisant ressortir les atrocités, les injustices, les brutalités et le racisme du projet colonial. Mudimbe va plutôt se focaliser sur la production des connaissances sur l’Afrique. Il fait, sur le modèle de son maître à penser Michel Foucault, de l’archéologie du savoir. Comment sait-on ce que l’on sait ? Comment connaissons-nous ce que nous connaissons sur l’Afrique ?
On peut reconnaitre ce même type de démarche chez Paulin Hountondji, Angelbert Mveng, Fabien Eboussi ou Kwasi Wiredu. En bon épistémologue-anthropologue, Mudimbe met l’accent sur le caractère insaisissable de tout un peuple. L’Afrique est un rhizome, pour emprunter le vocable de Gilles Deleuze. Elle a conservé des espèces anthropoïdes et végétaux extrêmement diversifiés.
Pour la connaitre, les colonisateurs ont cherché à l’homogénéiser et à l’infantiliser. La mission civilisatrice consistait à construire l’Africain comme une terre vierge sur laquelle il fallait cultiver la civilisation en détruisant les cultures. Ainsi, l’Afrique ne peut être connue qu’en la noyant dans un agenda homogène des puissances coloniales. Le fond de la pensée de Mudimbe est qu’en fait, les colons avaient en quelque sorte inventé l’Afrique dont ils parlaient.
D’où l’invention de l’Afrique, partant de la naissance même du terme Afrique à l’expérience coloniale et des mouvements de décolonisations et enfin du néocolonialisme. Le colonisateur a travaillé sur une certaine idée de l’Afrique. L’intuition épistémologique de Mudimbe est que toute tentative de compréhension des êtres sociaux nécessite de les inventer ou d’en faire un idéal-type à la Weber, c’est-à-dire en excluant toute sa riche diversité qu’on ne peut encapsuler.
La gnose africaine relève justement de ce type d’homogénéisation. Ainsi Mudimbe est resté critique du panafricanisme, à qui il reprochait d’avoir épousé les constructions coloniales. Est-ce toute tentative de compréhension ou de définition d’un peuple qui est une construction ou une invention ? L’argument de Mudimbe est que l’Afrique est une structure dynamique, constamment en mouvement à chaque époque, c’est donc ce mouvement qui est au cœur de sa recherche. Un continent qui est constamment changeant, en processus d’échange et de changement, ne peut être appréhendé que par une connaissance inventée.
Mudimbe est aussi connu pour sa réponse à l’historien Nigérian Aje Ajayi qui critique les intellectuels africains de donner trop d’importance à la colonisation alors qu’elle n’était qu’un épisode (de plus ou moins cent ans) dans la longue et riche histoire africaine. Ajayi a raison, car l’histoire de l’Afrique est multimillénaire ; les cents ans de la colonisation ne sont qu’un épisode de l’histoire.
Mudimbe reconnait la pertinence de la remarque d’Ajayi selon laquelle la colonisation n’a duré que 100 ans au maximum alors que l’histoire de l’Afrique est longue de plusieurs millions d’années. Cependant, souligne Mudimbe, l’expérience coloniale diffère des autres conquêtes que le monde a connues.
Il n’y a aucun autre événement dans l’histoire du continent qui porte une marque indélébile comme la colonisation.
Elle a transformé de fond en comble l’Africain au point qu’il ne peut se reconnaitre que comme un sujet colonial. Les colonisateurs ont réussi cet exploit en mettant en place une organisation triptyque qui consistait en une occupation physique de l’espace, une réforme des mentalités des indigènes et une ’intégration de l’économie locale dans l’économie occidentale du marché.
Dans cette expérience, l’Africain était considéré toujours comme un embryon à façonner à l’image du maître. Il fallait réduire toute complexité africaine a sa plus simple expression pour mieux manipuler son être. Là encore, il s’agit d’une invention de l’Afrique : de l’homogénéisation a l’infantilisation, l’Africain était tout simplement nie dans son être-au-monde. Le colonisé était tout simplement intégré dans l’espace-temps du colonisateur, dans le mensonge éhonté de la modernité coloniale.
La réponse à ces inventions ne nécessitait pas moins que des révolutions, la quête effrénée et brutale de la liberté. Haïti a réussi cela au prix du sang. Les noirs ont pu se libérer de l’esclavage et de constructions avilissantes du colonisateur.
Je pense que c’est la conclusion logique à laquelle la théorisation de Mudimbe nous conduit. Elle nous invite aussi à passer de la critique épistémologique à la créativité dans la manière de libérer notre continent. La déconstruction ou mieux la de-invention de l’Afrique exigent des Africains une grande créativité pour imaginer un arrangement social et politique ou chacun est reconnu dans sa différence culturelle, mentale et spirituelle.
La créativité exige d’autres types de talents plus précisément à notre époque où certains de nos frères de race sont tentés de continuer l’ouvre coloniale qui consiste à nous déstructurer ou à inventer contre notre gré. Les résultats des élections qui traduisent le génie du peuple Africain ne doivent pas être sabotés aux grès des alliances. Les disciples de Mudimbe doivent entendre cet appel. Le Congo est inventé par ses propres fils qui détruisent sa fabrique sociale sous le prétexte d’une modernité et tribale.
Adieu Maitre, nous te serons fidèles par la libération de notre peuple qui a nourrie toute ta vie intellectuelle et humaine !

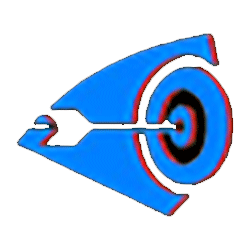



Comments est propulsé par CComment