La RDC face aux réalités d’un basculement géopolitique : pourquoi Félix Tshisekedi ne peut pas s’aligner sur Moscou
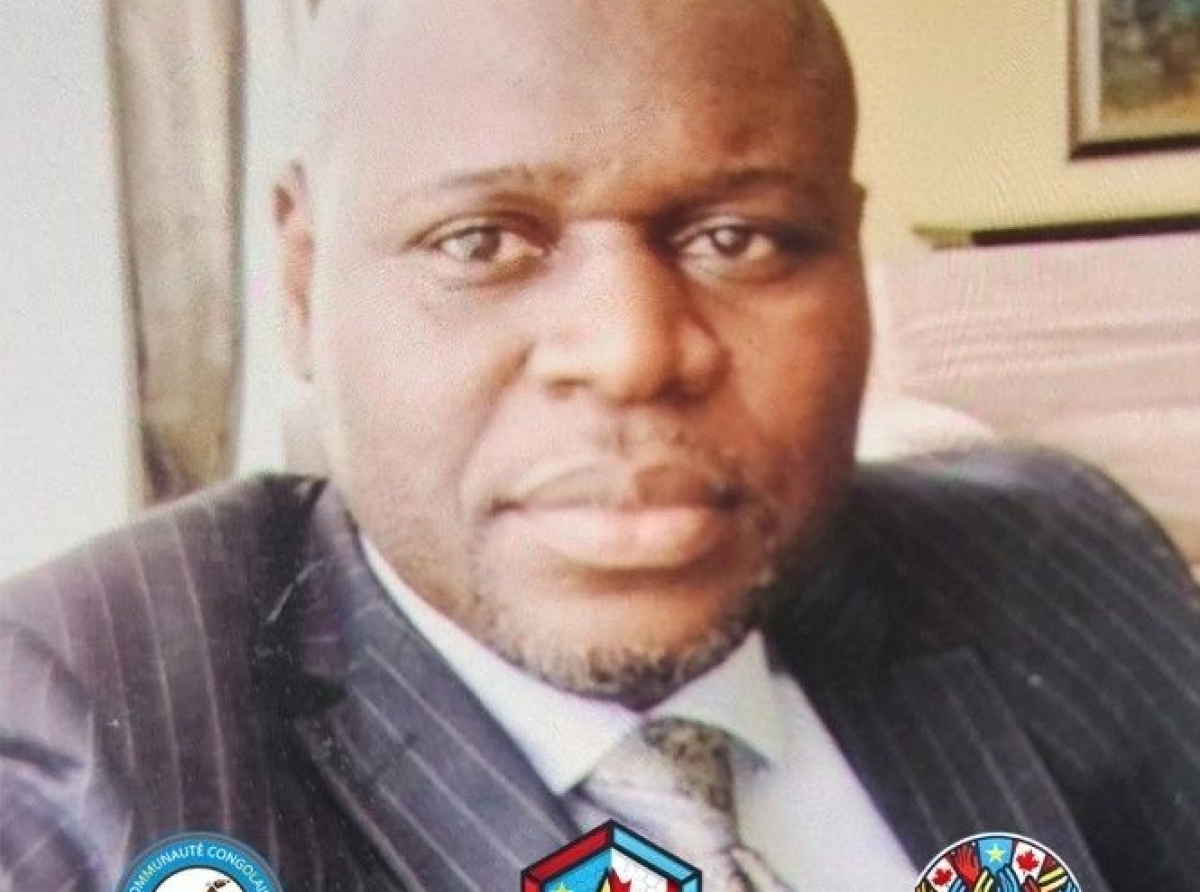
(Par Nico Minga, Economiste, auteur et géostratège)
L’Est de la République Démocratique du Congo demeure une poudrière géopolitique où s’entrecroisent les intérêts de puissances régionales et internationales. Dans un contexte de tensions exacerbées par l’activisme du M23 et l’agression rwandaise, une question se pose avec acuité dans tous les cercles de réflexion : pourquoi le président Félix Tshisekedi ne pourrait-il pas faire appel à la Russie pour stabiliser cette région stratégique ?
Un jeu d’alliances qui restreint les marges de manœuvre
Historiquement, la RDC s’est inscrite dans un axe de coopération avec les puissances occidentales. Les États-Unis, la France et l’Union européenne demeurent les principaux partenaires du pays sur le plan diplomatique et économique. Un basculement vers la Russie, dans le contexte actuel de guerre en Ukraine et d’alignements forcés, serait perçu comme une provocation susceptible d’entraîner des sanctions économiques et un isolement diplomatique.
L’administration américaine, qui a fait de la stabilisation des Grands Lacs une priorité stratégique, ne tolérerait pas un tel rapprochement. De même, l’Union européenne, principal bailleur de fonds en matière d’aide au développement et de programmes d’infrastructure, pourrait revoir son engagement en RDC si Kinshasa venait à opter pour une coopération militaire avec Moscou.
Rappelons que les relations entre la RDC et la Russie ont toujours été complexes et elles remontent à l’ère soviétique. Pendant la guerre froide, l’URSS a soutenu certains mouvements révolutionnaires en Afrique, mais la relation avec le Congo ex-Zaïre fut ambivalente. Mobutu, qui dirigea le pays de 1965 à 1997, était un allié clé des États-Unis, fermement ancré dans le camp occidental contre l’influence soviétique. L’Union Soviétique a pourtant tenté d’établir des alliances à travers des formations militaires et des coopérations discrètes, mais sans succès durable en raison de l’alignement pro-occidental du régime de Mobutu.
Après la chute du régime de Mobutu, la RDC n’a jamais véritablement développé de liens stratégiques solides avec la Russie post-soviétique. Depuis l’accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, les interactions avec Moscou sont restées limitées, malgré quelques échanges diplomatiques. Ainsi, il n’existe pas d’antécédents historiques favorisant une alliance militaire entre la RDC et la Russie, contrairement à d’autres pays africains comme l’Angola ou l’Algérie, qui ont bénéficié d’un soutien plus structuré de l’URSS.
L’influence économique et militaire occidentale comme verrou stratégique
La RDC reste un pays économiquement dépendant des institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, dont les décisions sont largement influencées par Washington et Bruxelles. Ces organismes conditionnent leur soutien à des engagements en faveur de la stabilité macroéconomique et de la gouvernance démocratique, des principes peu compatibles avec certaines méthodes d’intervention russes, qui s’appuieraient des fois sur des accords opaques en échange de concessions minières.
L’armée congolaise est historiquement équipée et formée par des partenaires occidentaux et chinois. Une intégration de matériel et de doctrine militaire russes impliquerait une refonte logistique et stratégique de grande ampleur, rendant cette transition complexe et plus coûteuse.
Par ailleurs, l’Occident face à l’émergence de nouveaux acteurs et dans cette dynamique géopolitique mondiale, l’Europe se trouve dans une position de recul, notamment en ce qui concerne la redistribution des ressources et l’influence économique en Afrique centrale. Jadis acteur central du développement, particulièrement en République Démocratique du Congo, le Vieux Continent semble aujourd’hui à la traîne face à la montée en puissance de nouvelles stratégies chinoises et américaines.
Bien que toujours présente à travers quelques entreprises et investissements dans l’exploitation des ressources minières, l’Europe n’a pas su s’adapter aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques. L'absence de vision stratégique cohérente, combinée à des investissements moins compétitifs et à des politiques parfois trop distantes des préoccupations locales, a réduit son impact. Contrairement à la Chine, qui capitalise sur des accords "minerais contre infrastructures" pour renforcer son influence, ou aux États-Unis, qui redéfinissent leur coopération à travers des initiatives comme le Partenariat pour la Sécurité des Minéraux (MSP), l’Europe n’a pas su se repositionner comme un acteur clé dans la redistribution des ressources naturelles en RDC.
Ce retrait de l’Europe dans la redistribution des ressources naturelles et l’affaiblissement de son rôle stratégique créent un vide dans lequel se sont insérés d’autres puissances, plus réactives et plus agressives dans leur approche. Ce recul de l’Europe ne se limite pas à une perte d’influence économique, mais également à un effacement progressif dans les domaines diplomatique et sécuritaire, laissant la place à des modèles plus flexibles et potentiellement plus controversés, comme ceux proposés par la Russie ou la Chine.
Un modèle d’ingérence controversé en Afrique
Les récentes interventions russes en Centrafrique, au Mali et au Soudan montrent un schéma récurrent : l’envoi de mercenaires, comme ceux du groupe Wagner, en échange d’un accès préférentiel aux ressources naturelles. Cette approche, si elle s’est avérée efficace à court terme pour sécuriser certains régimes, pose néanmoins des problèmes structurels : abus contre les populations civiles, absence de contrôle de l’État sur les forces déployées, et instrumentalisation des conflits locaux à des fins géopolitiques.
Une coopération militaire avec la Russie pourrait donc générer un climat d’incertitude et d’opposition au sein même de l’armée congolaise, qui peine déjà à contenir les dynamiques internes de fragmentation, de trahison et de corruption.
L’introduction de la Russie dans l’équation sécuritaire de la région des Grands Lacs risquerait également d’aggraver les tensions avec les États voisins. Le Rwanda, soutien du
M23, entretient des liens étroits avec la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, et pourrait interpréter une coopération militaire entre Kinshasa et Moscou comme une menace directe.
D’autre part, la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), qui a déjà déployé une force régionale pour stabiliser l’Est de la RDC, pourrait voir cette initiative compromise par une présence russe perçue comme une interférence étrangère non concertée.
Un pragmatisme stratégique pour Tshisekedi
Conscient des risques d’un alignement avec Moscou, le président Félix Tshisekedi privilégie une approche plus mesurée, combinant coopération avec l’ONU, via la MONUSCO, engagement avec les partenaires traditionnels et renforcement des capacités nationales.
Dans cette logique, Kinshasa explore des alliances avec des pays africains disposant d’une expérience éprouvée en matière de lutte contre les insurrections, comme l’Angola et l’Afrique du Sud, tout en consolidant ses relations avec les grandes puissances économiques que sont les États-Unis et la Chine.
En définitive, si la Russie cherche à renforcer sa présence en Afrique, la RDC ne peut se permettre de rompre l’équilibre fragile sur lequel repose sa stratégie sécuritaire et économique. La guerre à l’Est exige des réponses immédiates, mais toute alliance doit être évaluée à l’aune de ses implications géopolitiques globales.
Félix Tshisekedi, en optant pour un positionnement pragmatique, évite ainsi les écueils d’une polarisation excessive dans la guerre froide moderne qui oppose l’Occident à Moscou. Reste à voir si cette approche permettra une stabilisation durable de la région, ou si la RDC sera contrainte de repenser son architecture sécuritaire face à l’évolution du conflit.

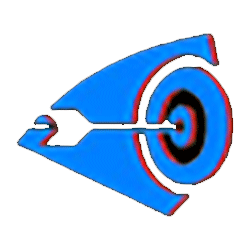



Comments est propulsé par CComment