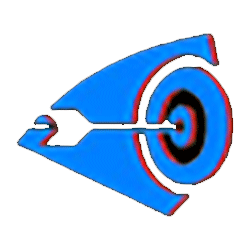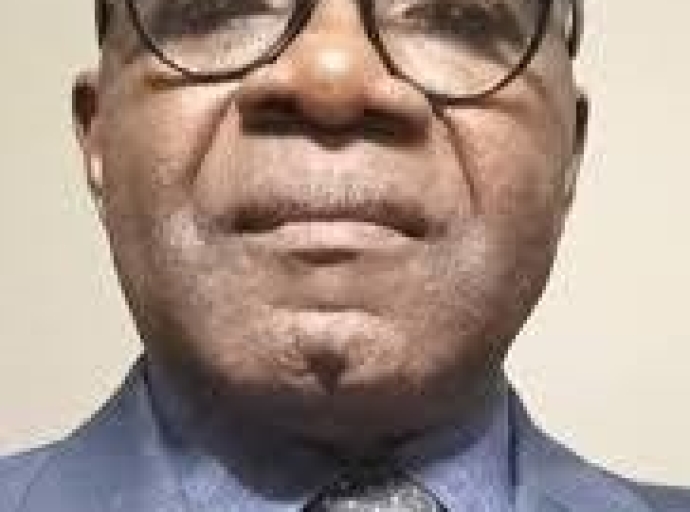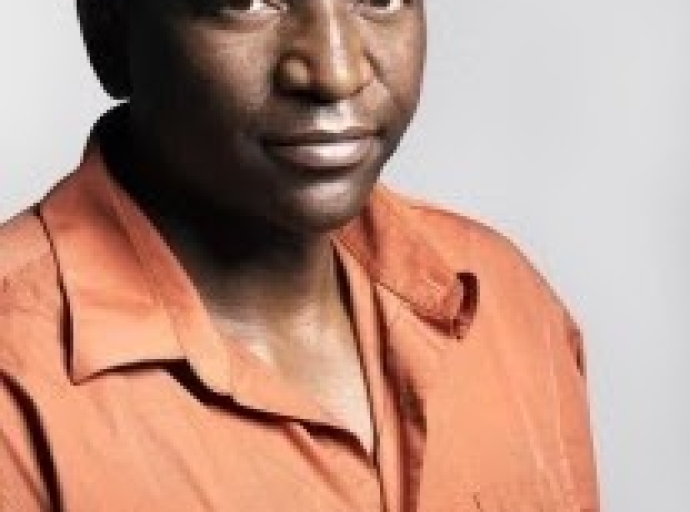« MAKE AMERICA GREAT AGAIN OU AMERICA FIRST »
(Par James Andersson NZALE, Président du CIEGS RDC AFRIQUE)
Avant toute chose, avant toute écoutons tous et partageons ensemble ces versets bibliques qui du reste représentent une petite exhortation pour nous, pour notre vie et pour notre mieux être social :
- Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera (Galates 6 : 5, 7 - 8) ;
- Qui sème le vent récolte la tempête (Osée 8 : 7 - 8) ;
- On vous mesura de la même façon que vous mesurez les autres (Matthieu 7 : 1 - 2) ;
- Les Egyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne le verrez plus (Exode 14 : 11 - 14) ;
- Quand les gens crieront paix, paix sur la terre, une ruine soudaine les surprendront (1 Thessaloniciens 5 : 3) ;
- La tour de Babel Dieu dit : Descendons et confondons-les (Genèse 11 : 1 - 9) ;
- Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. (Apocalypse 22 : 11 - 12).
Voilà la PROPOSITION DU PLAN D’ACTION PRIORITAIRE, GEOPOLITIQUE ET GEOSTRATEGIQUE A INSERER ET A ENRICHIR LE PROGRAMME DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE DU PRESIDENT DONALD TRUMP A EXECUTER DURANT SON DEUXIEME ET DERNIER MANDAT POLITIQUE DE 2025 A 2028 A LA TETE DES ETATS – UNIS D’AMERIQUE : « MAKE AMERICA GREAT AGAIN OU AMERICA FIRST » du CIEGS RDC AFRIQUE faisant suite et complétant les deux MEMORANDUMS DES NOIRS D’AFRIQUE VIVANTS SUR LE CONTINENT AFRICAIN ET DU CIEGS RDC AFRIQUE : ONG DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET INTEGRAL ET MIEUX ETRE SOCIAL EN RDC, EN AFRIQUE ET PARTOUT A TRAVERS LE MONDE ET ASBL A L’ATTENTION DU PEUPLE AMERICAIN SANS EXCEPTION ET EXCLUSION ET PARTICULIEREMENT AUX AFRO - AMERICAINS DES ETATS – UNIS D’AMERIQUE, AUX MEDIA AMERICAINS (PRESSE ECRITE ET AUDIOVISUELLE), AUX MEDIA EUROPEENS (PRESSE ECRITE ET AUDIOVISUELLE), AUX INSTITUTS DE SONDAGES AMERICAINS ET EUROPEENS, AUX INFLUENCEURS ET INFLUENCEUSES DE TIK TOK AMERICAINS ET EUROPEENS, AU PARTI DEMOCRATE AMERICAIN, AU PARTI REPUBLICAIN AMERICAIN, AUX ASSOCIATIONS SOCIO - CULTURELLES AMERICAINS, AUX ASSOCIATIONS SOCIO - ECONOMIQUES AMERICAINS, AUX ASSOCIATIONS SOCIO - PROFESSIONNELLES AMERICAINS, AUX SYNDICATS DES EMPLOYEURS ET DES EMPLOYES AMERICAINS, AUX EGLISES AMERICAINES, AUX ENTREPRISES AMERICAINES, AUX ONG AMERICAINES, AUX FONDATIONS AMERICAINES, AUX STARS DE MUSIQUE AMERICAINS ET AUTRES EN RAPPORT AVEC LE COMPORTEMENT A OBSERVER ET A DEVELOPPER, LES BONNES ATTITUDES JUSTES, VERIDIQUES, HONNETES, CORRECTES, CREDIBLES, INTEGRES, IMPARTIALES, NON PARTISANES ET TOTALEMENT DEMOCRATIQUES A CULTIVER A INCARNER, A DEVELOPPER ET A ENCOURAGER DURANT LA PERIODE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE AMERICAINE QUI AURA POUR ABOUTISSEMENT FINAL L’ELECTION DU 47ème PRESIDENT DES ETATS UNIS D’AMERIQUE LE MARDI LE 05/NOVEMBRE/2024 ainsi que les conclusions générales des grands enjeux de l’élection présidentielle du Mardi le 05 Novembre 2024 aux Etats – Unis d’Amérique.
Sans préjudice des principaux thèmes phares de la campagne électorale de 2024 qui devraient être développés par des candidats présidents des Etats – Unis d’Amérique pour expliquer, persuader, convaincre et faire comprendre à tout citoyen américain ou peuple américain sans exception et exclusion : grand et petit, homme et femme, jeune et vieux, libre et opprimé, riche et pauvre, ce que devrait être son projet de société et son programme de gouvernance dans les quatre (4) années à venir de 2025 à 2028, malheureusement, cela n’a pas été fait et cela n’a pas été le cas, les candidats à la présidence des Etats – Unis d’Amérique de cette année 2024 ont parfois versé directement ou indirectement ou par personne interposés dans des escalades verbales, dans les polémiques, dans le dénigrement et la diabolisation de l’autre adversaire politique jusqu’ à jeter le discrédit et l’opprobre sur l’autre sans se rendre effectivement compte de ce qu’ils étaient en train de faire et de dire au public et au peuple américain et ce que cela entrainera effectivement directement ou indirectement dans le subconscient, dans la tête et dans la conscience individuelle et personnelle du peuple américain au lieu d’aborder directement des questions majeurs, très sensibles et très stratégiques qui touchent directement la vie socio - économique du peuple américain auxquelles il est confronté au quotidien, des véritables problèmes et difficultés auxquels le citoyen et le peuple américain est quotidiennement confronté nuit et jour à savoir : la santé, l’éducation, l’environnement, l’économie, les mécanismes de la lutte contre l’immigration illégale, clandestine et abusive, ainsi que les enjeux locaux à savoir : le pouvoir d’achat du peuple américain, le logement, octroi des crédits au logement et la construction des logements sociaux, la lutte contre l’inflation, la crise de logement, pour des classes sociales démunies etc.
Ce qui est bien triste, regrettable, dommage, pitié, très ridicule et très honteux pour une très grande démocratie mondiale et planétaire qu’est les Etats – Unis d’Amérique. Alors qu’ils ont eu beaucoup ou suffisamment du temps et des moyens matériels et financiers pour le faire et développer aussi des thèmes hautement géopolitiques et géostratégiques durant leurs campagnes électorales à la présidentielle américaine de 2024. Il s’agit en effet essentiellement des thèmes, des matières et des questions clés sur le plan national et international que le peuple américain voulait aussi bien écouter leur avis, leur opinion, leur projet de société et leur programme de gouvernance politique et économique des Etats – Unis d’Amérique pour les quatre (4) années à venir de 2025 à 2028 durant la campagne électorale de 2024 que voici que le CIEGS RDC AFRIQUE à travers sa branche Internationale, planétaire et mondiale le CIEGS INTERNATIONAL ET PLANETAIRE considèrent et propose au Président Elu des Etats – Unis DONALD TRUMP de les insérer et intégrer totalement et globalement dans son plan d’action et programme de gouvernance politique durant son deuxième et dernier mandat et durant les quatre (4) années à venir de 2025 à 2028 à la tête des Etats – Unis d’Amérique :
- La lutte contre le terrorisme international ;
- La situation de la paix et la sécurité internationale au proche, moyen et extrême orient et la zone indo – pacifique ;
- La situation de la paix et la sécurité internationale en République démocratique du Congo et dans la région des grands lacs et à travers le monde ;
- Le processus de paix Israélo - palestinien ou le plan de paix Israélo - palestinien ;
- Les grands enjeux géopolitiques et géostratégiques des USA en Russie, en Syrie, en Israël, au Liban, en Turquie, en Iran, en Irak, en Palestine, en Lybie, au Soudan et en République Démocratique du Congo ;
- Le transfert officiel de l’Ambassade des Etats – Unis d’Amérique de Tel - Aviv (Jaffa) à Jérusalem (Stratégies, mécanismes de mise en œuvre) ;
- Les USA et le G7 ;
- Les USA et le G20 ;
- Les USA et le BRICS ;
- Les USA, la Crimée et l’Ukraine ;
- Les USA, l’OTAN et l’acte fondateur OTAN – Russie ;
- Les USA, l’Union Européenne et la nécessité de sa réforme et restructuration après le Brexit ;
- Le Brexit ou la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne ;
- Les USA et les Etats Américains (Organisation des Etats Américains) ;
- Les USA et traité de non-prolifération des armes nucléaires ;
- Les USA et l’accord avec l’Iran sur le nucléaire ;
- Les USA et la préservation de la planète, de l’environnement, le dérèglement et le réchauffement climatiques ;
- Les USA et les relations économiques transatlantiques, le Commerce mondial et l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC), OCDE, OSDE et le BRICS ;
- Les USA et les relations politiques, diplomatiques, géopolitiques et géostratégiques que voici : USA – Royaume Uni (UK), USA – Union Européenne (UE), USA – Union Africaine (UA) ;
- La maitrise de l’immigration américaine et européenne et le respect des frontières nationales comme mesures difficiles à prendre pour protéger les citoyens face au terrorisme international ;
- L’accord de libre-échange Nord-Américain et transatlantique ;
- La diplomatie agissante des USA en Europe, Afrique, Proche Orient, Moyen Orient, Extrême Orient et en Amérique du Nord et du Sud ;
- Les relations bilatérales : Usa – Mexique, Usa – Russie, Usa – Israël, Usa – Chine, Usa – Royaume Uni, Usa – Allemagne, Usa – Bruxelles, Usa – Japon, Usa – Corée du Nord, Usa – Corée du Sud, Usa – les Balkans et l’Europe de l’Est, Usa – Afghanistan, Usa – Pakistan, Usa – Inde, Usa – Birmanie, Usa – Ukraine, Usa – Crimée, Usa – Géorgie, Usa – Turquie, USA – OTAN, Usa – Union Européenne, Usa – Turquie, Usa – Iran, Usa – Irak, Usa – Afrique, Usa – Syrie, Usa – Liban, Usa – Union Africaine, Usa – Egypte, Usa – République Démocratique du Congo et autres ;
- La réforme, la suppression ou pas d’OBAMACARE et son remplacement par une autre Loi de Santé ou de Couverture Médicale Universelle ;
- La réforme fiscale aux USA tels que vu par le nouveau Président élu des Etats - Unis d’Amérique DONALD TRUMP ;
- La problématique, la possibilité et la mise en œuvre de la poursuite de la construction du mur de séparation avec le Mexique dans le cadre du programme du Président élu des Etats - Unis d’Amérique DONALD TRUMP dans la lutte contre l’immigration clandestine des sujets mexicains aux USA ;
- La réduction des impôts aux USA ;
- La guerre commerciale avec la Chine et la taxation des produits chinois (Made in China) fabriqués en Chine à la douane américaine ;
- L’Energie et la relance de l’industrie de charbon, du pétrole et du gaz sur le sol américain ;
- L’engagement des USA en rapport avec la Défense, la sauvegarde, la surveillance, la promotion, la protection planétaire de la Démocratie, des Droits de l’Homme, de l’Etat de Droits, de la primauté de la Loi et des Droits, de la liberté d’expression, de la liberté d’opinion, de la liberté de culte, de la liberté de manifestation, de l’autodétermination et le droit au développement des peuples de la planète ;
- L’engagement spécial des USA face à l’Afrique dans la problématique de la démocratisation des régimes politiques, du respect des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, Non et plus question des soutenir politiquement les dictateurs éternels africains qui sont restés longtemps au pouvoir politique et qui oppriment leurs peuples, de l’alternance démocratique, du respect de la Constitution ou Loi Fondamentale et les Lois de la République, de la fin des mandats éternels et à vie des Présidents Africains.
- L’engagement spécial des USA en rapport avec la reforme et la restructuration de l’OTAN ;
- L’engagement spécial des USA en rapport avec la Reforme, la REFONTE TOTALE et la RESTRUCTURATION DE L’UNION EUROPEENNE ;
- L’engagement spécial des USA en rapport avec la Reforme, la refonte totale et la restructuration de l’Union Africaine et de toutes les Organisations politiques, régionales non démocratiques et qui n’appuyent pas le principe de la démocratisation des régimes politiques des Etats membres, et le strict respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la déclaration universelle des droits de l’Homme, de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Union Africaine à savoir : la CEEAC, la CEMAC, la CEPGL, la SADC, la COMESA, l’EAC, la CIRGL et autres pour ainsi se conformer aux impératifs et exigences mondiales et internationales de la démocratie, de l’Etat de Droit, des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de la paix et sécurité internationale, de la lutte contre le terrorisme international et enfin le REFUS ABSOLU ET CATEGORIQUE des USA de tout soutien moral, politique et diplomatique et d’appui logistique et financier aux dictateurs africains, aux seigneurs de guerre des rebellions armées ainsi que la légitimation politique et diplomatique des pouvoirs non démocratiques issues des rebellions, des coups d’état et renversement par les armes des régimes démocratiquement élus ;
- Etudes des mécanismes, des voies et moyens et des possibilités du retrait total et définitif des USA de l’OTAN ;
- Retrait des toutes les troupes américaines dans les bases de l’OTAN en commençant par la base aérienne de l’OTAN de Ramstein en Allemagne ;
- Mettre définitivement fin à l’élargissement de l’OTAN ;
- Retour de l’OTAN dans les limites de 1991 conformément au compromis qui a été trouvé autrefois entre les Etats – Unis et la Fédération de Russie au lendemain de la chute de l’ex – Union Soviétique, ce qui contribuera à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Europe ;
- Rétablissement et reprise du dialogue direct et sans intermédiaire et de partenariat et cadre de concertation direct OTAN – Russie ;
- Retrait définitif des Etats –Unis d’Amérique de l’OTAN ;
- Arrêt total de financement des Etats – Unis d’Amérique de l’OTAN ;
- Dissolution pure et simple de l’OTAN, ce qui contribuera à la paix, la sécurité et la stabilité internationale et particulièrement en Europe.
- Etudes des mécanismes, des voies et moyens et des possibilités du retrait total et définitif des USA de l’ONU ;
- Etudes des mécanismes, des voies et moyens et des possibilités de reconsidérer et de revoir à la baisse le financement des USA de l’ONU ;
- Reconsidérer et diminuer la part et la contribution financière des USA aux charges de l’ONU et que l’argent récupéré servira désormais à améliorer les conditions sociales du peuple américain conformément au discours de campagne, au programme électoral et au projet de société du Président DONALD TRUMP et de sa gouvernance politique durant son deuxième et dernier mandat de 2025 à 2028 à la tête des Etats – Unis d’Amérique ;
- Retrait des toutes les troupes américaines de toutes les missions de maintien de la paix de l’ONU à travers le monde ;
- Mettre définitivement fin au financement des certaines Agences et branches spécialisées de l’ONU et cet argent doit désormais servir pour le mieux-être du peuple américain dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la création des emplois, des infrastructures, de logement, de la lutte contre la misère et la pauvreté des citoyens américains du pouvoir d’achat des citoyens américains etc. ;
- Retrait définitif des Etats –Unis d’Amérique des NATIONS UNIS ;
- Arrêt total de financement des Etats – Unis d’Amérique des NATIONS UNIS ;
- Etude des mécanismes de dissolution pure et simple des NATIONS UNIS pour avoir échoué de maintenir la paix et la sécurité internationale à travers le monde particulièrement en République Démocratique du Congo, en Ukraine, en Palestine, à Haïti, au Liban etc., ce qui contribuera à la paix et la sécurité internationale ;
- Reconsidérer rapidement les relations de collaboration et de coopération multilatérales entre les USA et l’Union Européenne en rapport avec des procès contre les géants technologiques et les grandes entreprises américaines du GAFA (Google, Amazone, Facebook et Apple) parfois abusivement condamnés dans des Cours et des Tribunaux européens à des très fortes amandes pour violation des normes de concurrences déloyales et abusives et que l’argent qui sera récupéré servira à relancer ces entreprises de la GAFA en vue d’améliorer les conditions sociales du peuple congolais au regards de discours de campagne, au programme électoral et projet de société du Président DONALD TRUMP de sa gouvernance politique durant son deuxième et dernier mandat de 2025 à 2028 ;
- Etude des mécanismes et des modalités pratiques de la restitution des milliards des dollars américains du peuple américain ou des contribuables américains dépensés par le Gouvernement ou l’Administration BIDEN pour financer la guerre en Ukraine par l’Union Européenne et par l’Europe collectif selon les promesses de campagne électorale du Président Elu DONALD TRUMP ;
- Reconsidérer rapidement les relations de collaboration et de coopération multilatérales entre les USA et la Cour Pénale Internationale (CPI) en rapport avec des procès politiques et des mandats d’arrêts internationaux politiques, politisés, illégaux et arbitraires et totalement dénoué de fondement juridique lancés contre certains leaders politiques de certains pays à travers le monde qui n’ont pas ratifié le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) au regard du discours de campagne, du programme électoral et du projet de société du Président DONALD TRUMP et de sa gouvernance politique durant son deuxième et dernier mandat de 2025 à 2028 ;
- Faire voter des lois au niveau du Congrès américains assorties des très fortes sanctions américaines contre toute forme d’abus de pouvoir et d’autorité de la Cour Pénale Internationale et de certains de ses animateurs dans leurs prise de décision en rapport avec des procès politiques et des mandats d’arrêts internationaux politiques, politisés, illégaux et arbitraires et totalement dénoué de fondement juridique lancés contre certains leaders politiques de certains pays à travers le monde qui n’ont pas ratifié le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI).
- La politique du Président élu des Etats - Unis d’Amérique DONALD TRUMP en rapport avec le soutien à la classe moyenne américaine désœuvrée ;
- Le bilan de 100 jours du nouveau Président élu des Etats – Unis DONALD TRUMP à la maison blanche ;
- La préparation spirituelle, morale, politique et stratégique du nouveau Président élu DONALD TRUMP après son élection le Mardi 05 Novembre 2024 à assumer valablement ses fonctions et ses responsabilités politiques de diriger les Etats – unis d’Amérique durant les Quatre (4) années avenir de 2025 à 2028.
Que la grâce du Seigneur Jésus - Christ, l’amour de Dieu le Père Céleste et Eternel des Armées et la Communication du Saint Esprit soient avec vous (2 Corinthiens 13 :13).
Que Dieu le Père céleste et Eternel des Armées vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur personnel et Maître Suprême JESUS - CHRIST (Actes 2 :21 ; 4 :11-13 ; 3 Jean 2 ; Ephésiens 1 :1-3).
Fait à Kinshasa, le 16/Novembre/2024
James Andersson NZALE LONGBANGO MONGA TSHAMBU
ISRAEL VAINQUEUR DES NATIONS
Président – Fondateur et Président Exécutif International
Et Chercheur du CIEGS RDC AFRIQUE ET ASBL
Grand Défenseur des Droits de l’Homme
Journaliste Manager et Professionnel
Char du Feu, Char d’Israël et sa Cavalerie
Le Vaillant Héros et le Grand Lion