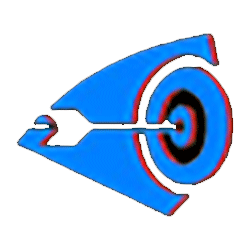La journée diocésaine de la jeunesse de la capitale a été célébrée à Kinshasa par le Cardinal Fridolin Ambongo, dimanche 23 novembre à l’esplanade du Palais du Peuple. C’était l’occasion pour le prélat catholique de Kinshasa de rappeler à l’assistance arrivée, de tous les coins de la capitale, que cette journée a coïncidé avec la fête du Christ, Roi de l’univers.
Cette célébration marque également la fin de l’année liturgique qui donne accès à la période de l’Avent qui précède les festivités de Noël. C‘est sur le thème principal : "Vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi" que le Cardinal a axé son homélie.
Le prélat de Kinshasa a commencé par déplorer que cette célébration intervienne dans un contexte où le pays est confronté à de multiples crises notamment, dans l’Est de la RDC, mais aussi à Kinshasa avec le phénomène Mobondo.
Et le Cardinal d’insister : "Comme vous le savez, nous célébrons cette journée dans un contexte inquiétant de notre pays, la République Démocratique du Congo: la guerre à l'Est, les conflits armés persistants, l'occupation de certaines provinces à l'Est de notre pays, des milliers de déplacés internes, la misère généralisée de notre population mais aussi et surtout l'expansion ici aux portes de Kinshasa du phénomène Mobondo qui pénètre déjà dans la ville, il suffit tout simplement d'aller au-delà de la rivière Mai Ndombe pour palper les conséquences de la présence des Mobondo. C'est dans les tourbillons de cette crise profonde que le Christ Roi vient nous proposer le chemin de l'espérance, de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Devenez donc chers jeunes, chers choristes des témoins d'une telle espérance".
De ce point de vue, l’Archevêque métropolitain de Kinshasa a exhorté les jeunes à participer pleinement à la vie du pays et de l’Église. Selon lui, ils ne doivent ni fuir leurs responsabilités ni se laisser distraire, mais s’engager pour bâtir "un Congo nouveau ".
"En cette année sainte du jubilé de l'espérance, je joins ma voix à celle du Pape Léon XIV qui invite les chrétiens à être des bâtisseurs d'espérance et non des spectateurs. Vous êtes appelés à participer pleinement à la vie de notre pays et de l'église. Ne fuyez pas vos responsabilités, ne dormez pas, ne soyez pas distrait mais engagez-vous pour un Congo nouveau, un Congo uni, juste, fraternel et prospère", a recommandé le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu.
En ce qui concerne le projet de Pacte social pour la paix, porté conjointement par l’Église catholique et l’Église du Christ au Congo, le Cardinal Ambongo a rappelé que l’espérance d’unité et de réconciliation repose aujourd’hui sur ce plan de sortie de la crise.
Alors que la convocation d’un dialogue autour de ce projet tarde à se concrétiser, et face aux murmures dans la sphère sociopolitique évoquant des tentatives de contourner cette initiative, le Cardinal a mis en garde : toute démarche qui ne prendrait pas en compte les causes profondes des crises serait vouée à l’échec.
"Dans notre pays, cette espérance d'unité, de réconciliation et de paix est aujourd'hui portée dans le projet du pacte pour la paix, la réconciliation entre congolais et le mieux vivre ensemble dans la région, la sous région des Grands Lacs. Ce projet porté conjointement par la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ du Congo (ECC), cette initiative vise à réunir notre histoire commune pour toucher les racines profondes de ce conflit en impliquant tous les acteurs de la crise, et toutes les forces vives du pays et spécialement vous les jeunes. Ce projet s'inspire du concept de Bumuntu notre être toujours déjà relationnelle, toute autre initiative qui se limite aux arrangements entre politiciens sans prendre en compte les causes profondes de la misère de notre peuple est vouée à l'échec et provoquera d'autres crises si nous ne rassemblons pas ensemble le peuple congolais autour d'une table pour vider leur sac", a insisté le Cardinal.
En RDC, plusieurs confessions religieuses parlent désormais d’une même voix quant aux pistes de sortie de crise dans l’Est du pays, marqué par l’agression rwandaise via la rébellion de l’AFC/M23. C’est dans ce cadre qu’une feuille de route commune pour le dialogue national a été rendue publique lundi 25 août à Kinshasa. Elle est portée conjointement par la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO), l’Église du Christ au Congo (ECC), la Plateforme des Confessions Religieuses du Congo, ainsi que la Coalition Interconfessionnelle pour la Nation (CIN).
La Pros.